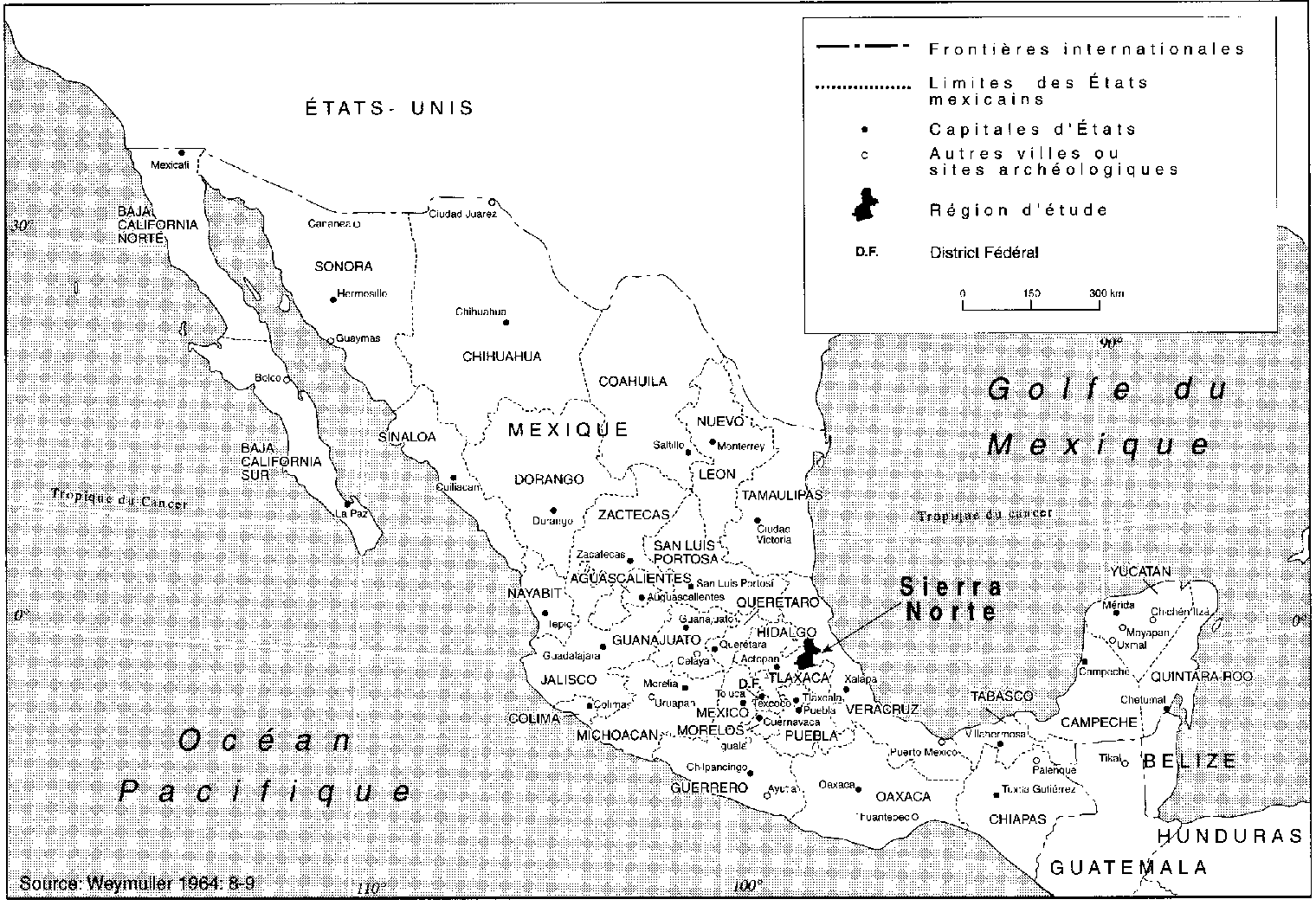
Depuis la fin des années 70, la problématique de l'identité ethnique et culturelle a fait l'objet d'innombrables études, tant en anthropologie qu'en sociologie. Si la formulation est nouvelle, plusieurs des thèmes regroupés sous cette nouvelle appellation avaient attiré depuis longtemps l'attention des anthropologues : la distinction du Soi (ou du Nous) et de l'Autre, la construction, par les acteurs, de modèles plus ou moins cohérents qui expriment la différence, et des interprétations de l'histoire en termes du destin d'un peuple, d'une nation, d'une ethnie. Dans son article intitulé Les sentiments acadiens, M.-A. Tremblay (1973) a voulu synthétiser les diverses composantes de l'identité ethnique acadienne. Les trois options méthodologiques qu'il nous présente sont les mêmes auxquelles est confronté le chercheur aujourd'hui : l'approche ethnohistorique, l'analyse institutionnelle, ou celle des « sentiments », qu'il identifie à la vision du monde (ibid., 296). C'est cette dernière voie qu'il choisira, parce qu'elle lui semblait coller davantage au vécu des acteurs que l'examen des seules normes ou institutions, et parce que les données ethnohistoriques disponibles apparaissaient par trop incomplètes (ibid.).
Au cours de mes recherches sur les autochtones de la Sierra Norte de Puebla, j'ai été amené à utiliser successivement les trois approches. Au début des années 70, une étude comparée des communautés nahuats et totonaques visait à dégager les structures sociales autochtones et la nature des liens avec le monde non autochtone (Beaucage, 1973a et b ; Durand, 1975 ; Labrecque, 1974 ; Paré, 1973). Une décennie plus tard, la montée d'un puissant mouvement amérindien dans la région m'amena à m'interroger plus particulièrement sur les composantes de l'identité ethnique telle que perçue par les acteurs (Beaucage, 1987, 1989, 1992a, 1993a). En même temps, à l'invitation d'un groupe local de recherche et de diffusion culturelle, le Taller de Tradición Oral, je participais à deux recherches : l'une sur la tradition ethnohistorique et l'autre sur les archives villageoises et régionales, les deux sources les plus couramment invoquées par les Amérindiens comme par les non-Amérindiens2 pour fonder les différences factuelles, mais proposaient chacune une structuration et une signification profondément divergente du passé.
Ce constat m'amena à m'interroger sur la notion même d'« ethnohistoire » et à découvrir que le terme est utilisé depuis des décennies par des ethnologues et des archéologues sans qu'un consensus véritable existe quant à son contenu. L'ethnohistoire se veut distincte de l'histoire au sens classique en ce qu'elle étudie « l'histoire des autres », de ceux dont on ne s'occupe généralement pas, parce qu'ils n'ont pas laissé de documents bien à eux, ou si peu. Par rapport à l'ethnologie, l'ethnohistoire se démarque également en ce qu'elle réintroduit la dimension temporelle dans les faits culturels et sociaux, dimension qui en fut soustraite lors de la redéfinition du champ de l'anthropologie à la fin du XIXe siècle (Lenclud, 1991 : 334).
Chaque grande « aire culturelle » a en fait développé sa propre tradition ethnohistorique. Pour un africaniste comme Jean Vansina, l'ethnohistoire est l'étude d'une tradition orale bien structurée, transmise par des spécialistes, comme celle qu'il a trouvée au Rwanda (Vansina, 1961). À l'opposé, pour les américanistes, le terme fait surtout référence à l'ensemble des sources écrites portant sur les populations autochtones à partir des premiers contacts avec les Européens : incluant aussi bien les admirables Codices de Mésoamérique que les chroniques de Cortez et de Cartier, ou les récits postérieurs de voyageurs et de missionnaires. À ces documents on ajoute aujourd'hui les traditions orales telles qu'elles se sont transmises dans les peuples amérindiens (voir par exemple Vincent, (dir.) 1992). Depuis que les autochtones ont fait irruption sur la scène politique en tant qu'acteurs, une troisième acception s'est fait jour, qui définit l'ethnohistoire comme « l'ensemble des procédures de mise en relation du présent au passé à l'intérieur d'une société ou d'un groupe, dans son langage et en référence à ses valeurs et à ses enjeux propres » (Izard et Wachtel, 1991 : 337) ; dans ce dernier sens, le terme correspond à ce que G. Sioui appelle l'« autohistoire » (Sioui, 1989).
L'imprécision dans la définition du champ de l'ethnohistoire a des conséquences importantes sur le plan de la méthodologie. L'histoire et l'ethnologie se sont historiquement structurées en des domaines considérés comme étanches. À la première, on a adjugé les sociétés qui possèdent une écriture et une forme d'État et qui organisent le passé en chronologies profondes ; à la seconde, les « peuples sans écriture », les « sociétés segmentaires » où règne un temps circulaire et où la tradition se fond avec le mythe dès qu'on remonte à plus de quelques générations (voir Lévi-Strauss, 1958 : 364-370). L'histoire a donc développé une approche critique du document, tandis que l'ethnologie construisait la méthode de terrain. En conséquence, les chercheurs des deux disciplines se trouvent relativement mal équipés pour aborder un domaine frontière, où les séries documentaires sont rares, relayées par une tradition orale qui possède une structure et des fonctions fort différentes. Depuis plus d'un demi-siècle, particulièrement avec l'École des Annales, les historiens ont délaissé l'histoire événementielle, pour s'intéresser à l'évolution des structures sociales et des mentalités. Les ethnologues semblent avoir été plus conservateurs et c'est beau- coup plus récemment qu'ils ont abandonné une perspective essentiellement synchronique des sociétés étudiées pour les envisager comme le produit de processus historiques3.
Dans les pages qui suivent, j'utiliserai successivement les sources orales et documentaires concernant une tranche de l'histoire des Nahuas de la région de Cuetzalan, dans la Sierra Norte de Puebla, au Mexique4 (voir carte 1). Mon but ne sera pas de les comparer terme à terme pour en dégager « la vraie version » des faits, mais bien de confronter les visions du passé que nous livrent les récits des anciens d'une part, les archives locales d'autre part. Tant les recoupements que les contradictions entre les deux types de sources nous permettront de comprendre mieux, je l'espère, la société autochtone actuelle et la manière dont elle mobilise le passé pour comprendre un monde dominé par des non-Indiens, et y légitimer ses pratiques.
Carte 1. La Sierra Norte de Puebla
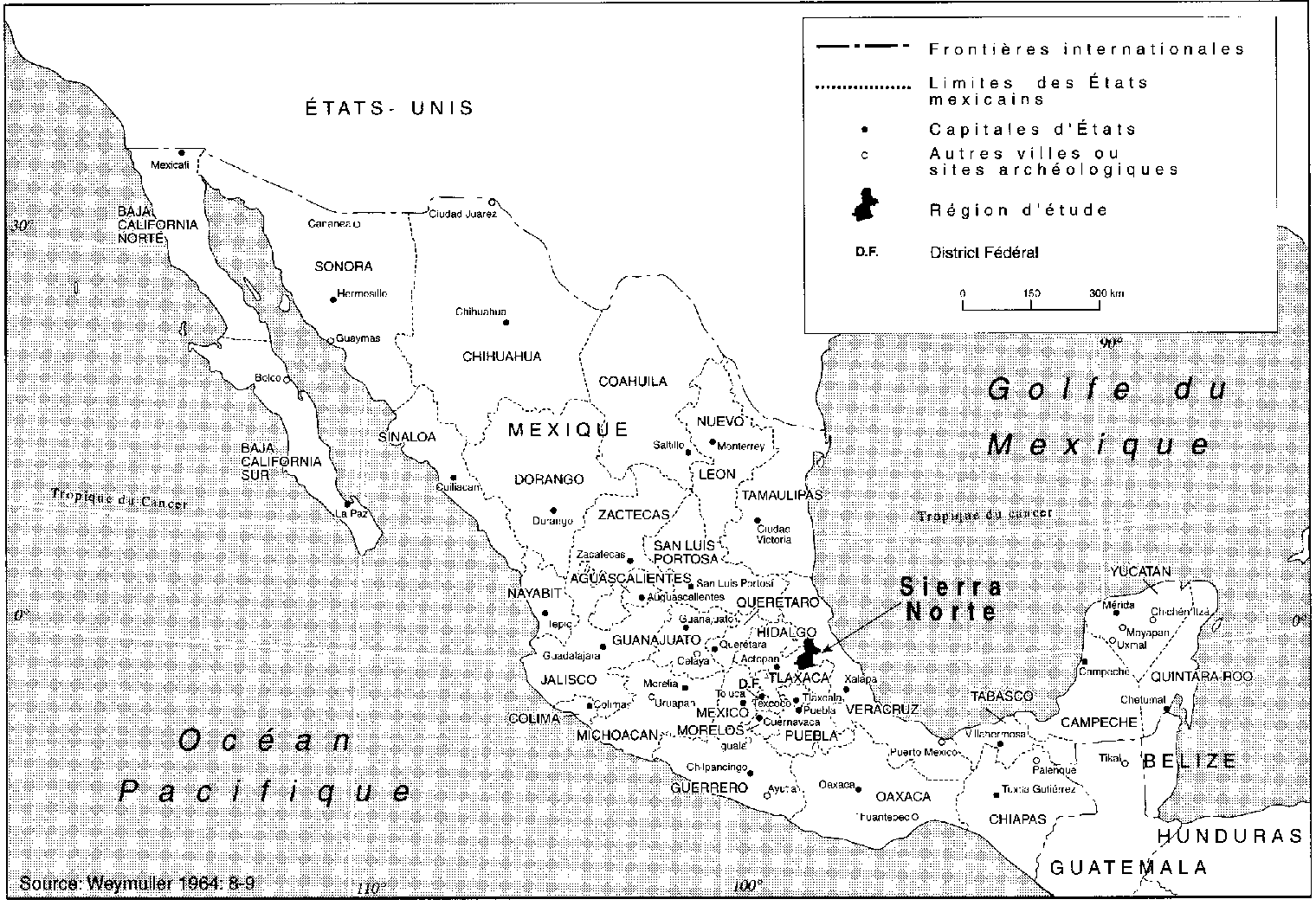
Lorsque les membres du Taller de Tradicion Oral du village de San Miguel Tzinacapan, dans la Sierra Norte de Puebla, m'invitèrent à m'associer à leurs activités (voir note 1), en octobre 1984, le groupe avait déjà recueilli plus de cinq cents mythes, contes et chants auprès des anciens de la région. Parmi ces derniers, un certain nombre de récits (tajtolmej) portaient sur la Révolution, l'invasion française de 1862-1867, la construction de l'église du village, etc. Parmi les divers « genres » du discours nahuat (Knab, 1983 et Beaucage, 1992a,) ces récits se démarquaient assez nettement : le narrateur les présentait comme une aventure vécue, soit par lui, soit par un parent ou un ancêtre. Les références spatiotemporelles abondantes semblaient servir à la fois d'aide-mémoire et de signes d'authenticité. Par ailleurs, ces récits ne formaient pas un ensemble relativement unifié et partagé par toute la communauté, au même titre que les récits mythiques de base ou les cycles de contes du lapin et du coyote. Je proposai aux membres du Taller de poursuivre l'exploration de ce volet de la tradition orale, pour lequel je suggérai le terme « ethnohistoire ». De ces recuerdos y vivencias des anciens, on résolut de faire une publication à part (Taller, 1994). Les récits déjà enregistrés portaient surtout sur les périodes les plus violentes : 1862-1867 (l'invasion française) et 1910-1917 (la Révolution). Le travail auquel je collaborai consista à combler les lacunes. En même temps, au-delà des événements (que nous ne négligions cependant pas) on mettait l'accent sur la reconstitution des coutumes, de l'organisation sociale, de l'économie paysanne, etc.
Les récits obtenus demeurèrent fragmentaires et souvent divergents, variant d'une famille à l'autre. En effet, c'est à ce niveau qu'est transmise la tradition ethnohistorique ; et ce, contrairement aux grands rituels, à la musique, à la danse, qui sont socialisés au niveau de la communauté à laquelle s'ajoutent, lors des fêtes, des invités des villages voisins. Pour certaines périodes, les données recueillies permirent de brosser un tableau assez complet de la vie autochtone. C'est le cas pour le début du XXe siècle : nos informateurs, souvent octogénaires, avaient gardé des souvenirs vivaces de « comment on vivait avant la Révolution » [de 1910] [keniuj tinenkej achto peuak in kuejmol], ou « quand j'ai pris connaissance » [ijuak nixpetantok]. Pour ce qui est des périodes précolombienne et coloniale, les données étaient beaucoup plus rares et portaient essentiellement sur des faits exceptionnels : par exemple, l'origine de tel site archéologique ou la construction de l'église. Je me limiterai ici à la période qui s'étend des origines à 1880, en me servant d'exemples tirés du corpus de données du Taller de Tradición Oral.
Les récits et fragments suivants se rapportent à un autrefois imprécis, qui se distingue cependant du temps originel des mythes par les références spatiales concrètes qui le rattachent au quotidien autochtone.
Extrait 1 :
Au temps où il y avait là-bas des Indiens (maseualmej ¾ voir note 2) des oiseaux sont passés, [c'étaient] des trogons (kuesaltotot, Trogon mexicanus) qui revenaient pour la nuit. Certains se sont demandé : « Quelle sorte d'oiseau est-ce ? » On leur a répondu : « Des kuesaltotomej ». C'est pourquoi on l'a appelé Cuetzalan, mais le vrai nom c'est Kuesalan, pas Cuetzalan, comme l'appellent les Métis (koyomej). (Taller, 1994 : I : 2)5
Extrait 2 :
Je n'ai jamais entendu parler de « pyramides ». Quand j'ai pris connaissance on disait que Yohualichan [le site archéologique] était un village, que c'était le village des anciens. Il y avait des musiciens ; ils jouaient de la flûte et à minuit, ceux qui passaient dehors les entendaient. [...] Au pied de la colline était ce village de Yohualichan, c'est le village de ceux-d'il-y-a-longtemps (uejkaujkayomej). (ibid., I : 5)
Extrait 3 :
On dit qu'ils faisaient des fêtes comme nous. Ils tuaient un garçon de douze ans, et sinon, une fillette ; ils tuaient un être humain (kristianoj) de douze ans. C'était ça leur fête. Ils y pensaient, ils y pensaient toujours et ils auraient continué, mais on leur a dit qu'on ne voulait pas qu'ils tuent des êtres humains. Peut-être on les avait dénoncés à Mexico et c'est comme ça qu'on a abandonné cette coutume [...] Car ils le tuaient et avec son sang ils écrivaient, ceux-d'il-y-a-longtemps qui vivaient à Yohualichan [...] Cette coutume a commencé, ils y ont pensé quand ils sont arrivés là pour y établir leurs maisons. Ils lui arrachaient le coeur et ils le mettaient dans un plat et ils faisaient leur fête. Qui sait pourquoi ils pensaient ainsi, ils n'avaient pas les images des saints (todiostsitsin) alors qui sait pourquoi ils pensaient ainsi ? (ibid., I : 6)
Extrait 4 :
Quand j'ai pris connaissance, mon père disait qu'il y avait là [à Yohualichan] une église (Tiopan). On disait que c'était une église à cause des petits « carreaux » [les niches ornementales] qu'ils appelaient des « saints ». (ibid., I : 2)
Dans l'extrait 1, l'utilisation de l'expression « au temps où il y avait là-bas des Indiens » (kuando ne ompa yetoya maseualmej) illustre un procédé fréquent dans la tradition orale nahuat : établir l'antériorité de l'enracinement amérindien sur tous les points du territoire. Ici, on conteste et la prononciation et l'étymologie du nom du municipe données par les hispanophones, qui y voient une référence au prestigieux quetzal (Pharomachrus mocinno) (Beaucage, 1993a : 28). Le fait de détenir le « vrai » nom et le « vrai » sens permet de réincorporer symboliquement à l'ensemble du terroir autochtone le chef-lieu, aujourd'hui habité par des Métis.
Dans l'extrait 2, c'est aussi l'attribution du nom qui est contestée, cette fois le mot espagnol piramide utilisé par les archéologues et les visiteurs, puis les Métis du chef-lieu, pour désigner le site précolombien de Yohualichan (« la-maison-de-la-nuit »). On contraste l'appellation extérieure, jargon vide de sens, avec la tradition orale qui permet de comprendre qu'il s'agit d'un village d'autrefois dont les habitants se manifestent encore. D'autres résidants des environs rapportent d'ailleurs avoir entendu les claquements que font les mains des femmes en confectionnant les tortillas, un coq qui chante ou un âne qui brait. Ce contact sensoriel avec le monde passé se produit à minuit, moment de rupture/jonction entre les deux journées, ou bien à midi, autre moment de rupture temporelle pour les Amérindiens mésoaméricains : « sous le figuier (amakuouit, Ficus sp.) apparaissait alors une femme, ou peut-être un prêtre, et là même, disparaissait » (Taller, 1994 : I : 8).
L'extrait 3 manifeste, dans cette continuité qu'on veut établir par rapport aux origines, une rupture essentielle, symbolisée par la mention des sacrifices humains. La phrase « Et avec le sang ils écrivaient » fait référence aux arabesques ocrées préservées en quelques points sur l'enduit de stuc qui recouvre encore une partie de la pyramide. Rien qui soit plus étranger aux rituels des Nahuas contemporains, qui offrent des fruits et des pâtés de maïs aux défunts et allument des cierges aux images saintes (todiostsitsin : « nos-petits-dieux ») : « Qui sait pourquoi ils pensaient ainsi ? » La rupture avec le passé s'articule avec la même altérité que nous avons décelée dans les extraits précédents, cette fois, sous la forme du pouvoir : « On les avait dénoncés à Mexico... ». Le Tenochtitlan précolombien s'efface ici devant la capitale d'aujourd'hui, siège d'une bureaucratie puissante et « étrangère », d'où émanent décrets et interdits.
L'extrait 4 illustre, quant à lui, comment le présent est constamment sollicité pour la reconstruction du passé : les « niches », ornements architecturaux propres aux pyramides de la région totonaque, trouvent leur explication dans le rituel catholique : c'est là que les statues des saints s'offrent à la vénération des fidèles.
Dans plusieurs récits portant sur les temps anciens, on voit intervenir les Espagnols. Mais la Conquête, pour la mémoire nahua, est loin de constituer le début de trois siècles de domination. Comme le relate un ancien :
Extrait 5 :
D'abord sont venus les Espagnols, mais Hidalgo les a chassés. Jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais pensé revenir, mais on dit qu'un jour ils vont vouloir revenir : ceux qui vivront le verront. Mais ce conte demeurera comme il a commencé. Parce que ça recommencera. Hidalgo les a chassés et les a vaincus : je l'ai lu dans l'Histoire, dans le livre. Ça lui a pris onze ans et onze jours à Hidalgo, pour arranger ça. (Taller, 1994 : II : 1).
Dans la Sierra, les connaissances relatives à la Conquête (1521) et aux guerres d'indépendance (1810-1821) proviennent de l'évole, et des allusions qu'on y fait lors des fêtes patriotiques du 15 septembre. Ce qui est frappant ici, c'est la réappropriation-réinterprétation de ce discours patriotique officiel. L'expulsion des Espagnols est vue comme suivant de très près la Conquête, la durée de la présence espagnole (en fait, trois siècles) est limitée à celle de la guerre de libération ! Pour les autochtones, ce n'est donc pas « la nation mexicaine » qui a chassé la puissance coloniale, ce sont les Indiens6. Et, en toute logique, les Nahuas incluent sous l'appellation koyomej (« étrangers ») les Mexicains hispanophones, qui ne peuvent qu'être des descendants des envahisseurs (même si, physiquement, ils diffèrent souvent fort peu des autochtones.
D'autres récits, cependant, suggèrent une domination espagnole prolongée, qui s'est traduite par la conversion au catholicisme, et l'enfouissement, au sens propre, de la culture amérindienne préhispanique.
Extrait 6 :
Un groupe de moines est venu, des religieux, et ils apportèrent la religion catholique. Alors les anciens, qui adoraient leurs idoles, les appréciaient beaucoup, c'était leur religion, pour ne pas que les Espagnols (gachupines) les détruisent, ils ont formé ces buttes et c'est demeuré caché : leur palais, leur temple [...] ils l'ont caché, ils ont jeté de la terre dessus. Là-bas, à Sotolan, on voit encore un muret de pierres... (Taller, 1994, I : 8).
De même, les récits de fondation du village de san Miguel Tzinacapan entremêlent les migrations des aïeux et la découverte d'une source avec les avatars de la construction de l'église, symbole majeur de l'identité locale depuis l'évangélisation.
Extrait 7 :
Ils faisaient leur église à Tecolapan [...] Mais ils n'avaient pas pensé à l'eau, car là, il y a de l'eau seulement sur la falaise [...] Sotolan n'a pas de source, seulement des citernes (aichkual) [...] Ensuite, ils ont trouvé une source à Tatsaualoyan, dans la montagne, et, satisfaits, se mirent à construire leur église. Mais quelqu'un leur dit : « Cette eau, c'est bien et elle vous suffit. Mais ensuite vous serez un village, vous vous multiplierez, frères, et il vous faudra une source non pas dans la montagne, mais au milieu du village. C'est pour ça qu'on dit que les anciens, peut-être les plus vieux et les plus entreprenants, sont venus par ici chercher une source. Ici c'était un amas de rochers, impraticable, une forêt. Ils ont trouvé une source, ils ont défriché [autour] et se sont réjouis car ce serait ici leur village. Ils ont ouvert des sentiers, des chemins, en pensant qu'ici serait établi leur village [...] Et, près de la fontaine (apan), voletaient beaucoup de chauves-souris (tsinakamej), battant des ailes [...] On peut les voir accrochées aux parois, là d'où l'eau jaillit ; c'est leur demeure. C'est pour ça que ça s'appelle Tzinacapan [" fontaine-aux-chauves-souris »]. (ibid., I : 9)
Extrait 8 :
On dit qu'autrefois il y a eu un concours entre San Miguel et Cuetzalan : le premier qui construirait son église et la couvrirait serait le [chel-lieu du] municipe. Ceux de San Miguel construisirent leurs murs les premiers et ensuite, commencèrent à poser les tuiles du toit. Ceux de Cuetzalan commencèrent ensuite, mais firent le toit de feuilles d'anaykuouit [Beilschmedia anay]. C'est pourquoi ils gagnèrent et le chef-lieu s'établit là-bas. (ibid., 1 : 11).
Il se dégage des « récits des temps anciens » un certain nombre d'idées maîtresses. La plus évidente, c'est bien sûr le lien entre le groupe et son terroir. La référence au lieu remplit ici une double fonction. D'abord, elle établit l'authenticité du récit : on peut vérifier l'existence des murets de Sotolan, de la source de Tatsaualoyan7. Une fois le récit ainsi authentifié, il devient à son tour fondement de l'appropriation symbolique du terroir, en établissant l'antériorité d'occupation. Antériorité par rapport à l'Autre, au non-indien, au koyot, toujours sous-entendu même dans les récits où il n'est pas explicitement mentionné. Ainsi, le long fragment sur la fondation du village exclut, par omission, le rôle qu'a dû jouer le clergé pour la construction de l'église : la collectivité autochtone est ici présentée seule face à son destin et l'archange saint Michel, le patron du village, est devenu simplement todios (« notre dieu »).
Dans ce deuxième groupe de récits s'ajoutent aux référents spatiaux des indications temporelles assez précises, souvent comme mention d'un témoin oculaire : « Un homme de Zacapoaxtla que mon grand-père a connu... » Les plus anciens d'entre eux se rapportent à l'intervention militaire franco-autrichienne (1862-1867) qui tenta d'imposer aux Mexicains l'empereur Maximilien (Garfias, 1983) et que la tradition orale rapporte comme « la guerre des analteko » (« ceux-de-l'autre-côté » s.-e. : « de la mer »). Ce volet de la tradition locale est particulièrement riche, ce qu'on peut relier au fait que la région fut envahie et occupée par les troupes franco-autrichiennes et que deux autochtones, Juan Francisco Lucas, en haute montagne, et Francisco Agustin Dieguillo (Palagosti), en basse montagne, menèrent la lutte armée contre les troupes étrangères.
Extrait 9 :
Un homme est arrivé [Maximilien], on dit qu'il était analteko. Il s'est nommé président. Il envoyait ces gens dans nos villages, chez nous qui travaillons la terre ; et ils emportaient tout ce qu'ils trouvaient, à leurs bureaux. C'est comme ça que la guerre a commencé [...] Et nous les avons renvoyés de l'autre côté de la mer, nous les avons reconduits de l'autre côté... (Taller, 1994, II : 1)
Extrait 10 :
La guerre, c'est le père de Juan Francisco qui l'a commencée, il s'appelait José Manuel [...]. Il était maire [d'un village] et ils lui ont dit d'apporter l'argent à Zacapoaxtla, et il n'a pas apporté la quantité demandée, alors ils l'ont saisi par le col de sa chemise et l'ont frappé contre la table. Il s'en est offensé et [à son retour au village] il a dit à son fils : « Il faut aller dire aux gens, peut-être qu'ils nous aideraient à aller les voir, à les chasser, mais pas seulement à les chasser, à les reconduire jusque chez eux ». (ibid., II : 2)
Extrait 11 :
L'homme qui a vendu un terrain à mon père nous disait que [Juan Francisco Lucas] s'est caché là, à La Providencia, quand on a perdu, à Cuetzalan, et qu'ils en chassèrent tous les paysans. Palagosti l'a caché et Lucas a même mangé des larves du xonokuouit [heliocarpussp.] que la femme de Palagosti cuisinait pour lui. (ibid., II : 3)
Extrait 12 :
On dit que lors du premier combat qu'a gagné Lucas, ici à Acapulco, il venait des gens [soldats], pas mal de gens, comme si c'étaient des fourmis noires, beaucoup, beaucoup de gens. Et ils ont commencé à arriver, à arriver, ils [les Indiens] les ont tués au pont de l'Apulco, ceux qui montaient sur la pente, ils les tuaient, ils faisaient rouler des pierres et ils en tuaient six ou sept avec une seule pierre. Il en est mort des milliers. [...] Ils avaient fait transporter les pierres aux femmes, jusqu'au moment de la montagne. (ibid.)
L'opposition ethnique, latente dans le premier groupe de récits, devient ici manifeste. Les envahisseurs étrangers, installés au gouvernement, à Mexico, furent vaincus par les autochtones. D'abord, Lucas, qui commanda l'offensive dans toute la Sierra, était bien un indien : à preuve, il mangea des larves de xonokuouit ! Ensuite, la tactique de combat employée à Apulco implique une connaissance précise du terrain et la collaboration physique des femmes, toutes choses qui ne se trouvent que chez les autochtones. (La tactique fut sans doute suggérée par les avalanches naturelles qui se produisent le long de cette rivière fortement encaissée, à la limite sud du municipe de Cuetzalan.) Et enfin, les récits suggèrent qu'identité ethnique et identité de classe se fondent : contrairement aux Indiens des campagnes, les commerçants métis des bourgs de Cuetzalan et de Zacapoaxtla prirent fait et cause pour les envahisseurs : « Nous avions perdu à Cuetzalan, on en chassa les paysans (rancheros) ».
À partir de l'invasion française, les souvenirs de luttes militaires se mêlent pour les autochtones avec un autre genre d'invasion. Après 1870, de nombreux Métis (gente de razón) et des immigrants italiens vinrent s'établir en basse montagne, attirés par la possibilité d'y acquérir des terres amérindiennes, à la suite de la suppression des titres communaux (Loi Lerdo de 1856, appliquée après la guerre d'intervention). Non seulement les deux événements eurent-ils lieu en même temps, mais le leader indien Palagosti dirigera une résistance armée contre l'appropriation des terres par les nouveaux venus (Thomson, 1991).
Extrait 13 :
Avant, il y avait beaucoup d'Indiens dans la ville de Cuetzalan, et peu de Métis, pas comme aujourd'hui. Et les maisons étaient couvertes avec des feuilles sur toute la rue. Je voyais ça quand j'avais douze ans [1909-1910] ; quand mon père m'emmenait au marché, on ne voyait que des maisons couvertes de feuilles. Mais il n'y a jamais eu que des Indiens. Il y avait toujours des étrangers (koyomej). (Taller, III : 1)
Extrait 14 :
Palagosti l'a emporté sur les analtekos, il les a retournés d'où ils venaient. Juan Francisco Lucas8 a nommé Palagosti maire, oui, un maire indien à Cuetzalan, pour qu'il commande : il disait aux Métis de faire ceci ou cela et aux Indiens de venir pour porter un message [...] C'est Palagosti qui a fait le premier hôtel de ville et la première église. J'ai moi-même vu cette église. Après Palagosti est venu A.M., qui était un étranger. D'abord, un Indien, puis ils ont tous été des étrangers. Oui, ensuite, tout a changé. C'est comme ça que ça s'est passé. (ibid., III : 1-2)
Extrait 15 :
Il [Palagosti] a jeté les étrangers dehors de Cuetzalan ! Mais l'homme qui est venu après lui était un imbécile (pendejo) ! Il les a de nouveau laissés entrer, en échange d'un peu d'argent qu'il a dépensé. Et il a fini ses jours à nettoyer le parc, avec sa houe, pour les Métis !*(pour la signification de l'astérisque, voir note 5)
Pour la tradition orale, la fin du XIXe siècle a donc été le théâtre de deux luttes parallèles : Indiens contre analtekos et Indiens contre Métis. Dans les deux cas, on trouve la figure centrale de Palagosti. Mais les deux luttes ont eu des résultats contraires : les analtekos ont été défaits et « renvoyés d'où ils venaient », tandis que les Métis, qui furent les alliés des envahisseurs, non seulement sont restés, mais ont vu leur pouvoir s'accroître. Ce n'est pas le comportement du héros qui est ici en cause : « il a foutu à la porte les Métis comme il avait foutu à la porte les envahisseurs ». Si certains informateurs accusent un successeur (anonyme) de trahison à la cause indienne, la plupart mentionnent des causes économiques.
Extrait 16 :
Alors sont venus les G. (famille métisse bien connue de Cuetzalan). Et ils ont installé leur décortiqueuse. Tous ces étrangers qui ne sont pas d'ici sont venus à Cuetzalan. Ils achetaient du café et le décortiquaient avec leurs machines. Et, après la venue des Métis, même les Indiens qui avaient de l'argent ont commencé à acheter leurs propres machines à décortiquer le café. Mais nous, qui sommes toujours pauvres, nous ne pouvons pas joindre les deux bouts, eh bien, ça n'a pas été mieux. Et ceux qui ont toujours de l'argent, ils nous trompaient, ils trichaient avec leurs balances quand on leur vendait notre café. (ibid., III : 3)
Extrait 17 :
Les vieux nous disent que beaucoup de gens, qu'ils appelaient ajkopauanij (« ceux-d'en-haut ») sont venus à Cuetzalan. Ils disaient : « Prête-moi ta maison [c'est-à-dire : ton terrain] et va travailler aux champs, je vais m'en occuper, ne t'inquiète pas : quand tu reviendras, ce sera toujours à toi. " Nos maisons, certains ont été honnêtes et leur ont rendues. D'autres ont répondu : " La maison est à moi maintenant, parce que la loi dit : Si je reste ici pendant plusieurs années, la propriété m'appartient. » (ibid., III : 4-5)
Si les autochtones revendiquent une antériorité d'occupation sur l'ensemble du territoire, qu'ils appuient sur les récits de fondation et la toponymie, ils expliquent par l'histoire récente la prédominance métisse. Explication ne veut pas dire légitimation cependant : les étrangers se sont enrichis par la fraude commerciale et l'abus de confiance. Alors que les combats antérieurs s'étaient bien terminés, c'est-à-dire par l'expulsion des intrus, en ce qui a trait aux Métis (également désignés comme étrangers), le discours sous-entend qu'il y a encore une injustice à corriger. À partir de la fin du XIXe siècle, l'opposition Indien-étranger devient permanente et prend une forme spatiale : la lutte entre le chef-lieu et les villages.
À l'analyse, la tradition se révéla donc « ethnohistorique » dans un deuxième sens, que je ne soupçonnais pas au début. Le foisonnement des récits est en effet doté d'un fil conducteur, d'un principe organisateur qui en fait un ensemble cohérent : l'opposition entre un Nous amérindien (maseual), associé au terroir, à l'histoire profonde, et un Autre, étranger (koyot), englobant l'Espagnol, le Français et le Métis, associé à l'ailleurs et à l'histoire récente.
Cette recherche sur la tradition orale, et la présence d'un mouvement paysan autochtone, à partir de 1976, influencèrent profondément mon interprétation de l'histoire sociale de la région : j'y faisais une large part aux relations interethniques, lesquelles semblaient coïncider, dans leurs grandes lignes avec les rapports économiques dans la région : une bourgeoisie commerçante métisse, en lutte avec une paysannerie autochtone pour des enjeux à la fois économiques (le contrôle de la terre et de la production), politiques (la direction de l'appareil politique régional comme des appareils locaux) et culturels (pressions acculturatrices) (Beaucage 1987). Cette interprétation correspondait d'assez près au discours des nouveaux leaders autochtones et de certains de leurs conseillers. La possibilité de consulter les archives municipales de Cuetzalan, qui nous fut offerte en 1987 par le nouveau maire, Don Agustin Ramiro, permettait d'aller vérifier les dimensions quantitatives, matérielles, judiciaires, de ce processus de lutte économique et politique où la dimension ethnique semblait occuper la place centrale.
L'analyse des milliers de documents répertoriés et recopiés à Cuetzalan et San Miguel Tzinacapan par mes collaborateurs et moi-même est loin d'être terminée. Cependant, on peut affirmer dès maintenant qu'elle nous offre une vision beaucoup plus complexe que le schéma domination/résistance ethnique suggéré par le matériel oral. Par ailleurs, notre travail a été facilité par la publication du livre de Garcia Martinez (1987) qui avait passé au crible les archives mexicaines concernant la Sierra pour les XVIe et XVIIe siècles ; les plus anciens documents que nous ayons trouvés (XVIIIe siècle) permettent d'établir une continuité avec ses travaux.
La plus ancienne référence historique à Cuetzalan concerne une agglomération du nom de « Quetzalcoatl », qui, en 1533 fait partie de l'encomienda de Pedro Cindos de Portillo9. Sa population diminuera fortement au XVIe siècle : à tel point qu'on réduira le tribut annuel à payer de 4 charges et demie de couvertures tissées (90) à une seule, en 1554 (Garcia-Payón, 1965 : 63, note 43). À la même époque, dans le contexte de la politique espagnole de regroupement des autochtones (congregaciones), les villageois déménagent « hors des ravins et montagnes où ils vivaient auparavant » (Garcia-Martinez, 1987 : 163). Le village, dont on estime la population à environ 240 habitants (ibid., 324), obtient alors une concession officielle de terres (merced) (ibid., 358). Au début du XVIIe siècle, il est déjà constitué en paroisse avec un prêtre résident ; on y cultive le maïs, le coton, le piment et on y élève poules et dindons (De la Mota y Escobar, 1940 : 225). En 1646, l'évêque de Puebla y dénombre plus de deux cents familles et affirme que « leur église est l'une des meilleures » de la région (Palafox et Mendoza, 1643-1646, f76r).
Cette croissance entraîne le fractionnement des communautés, comme ailleurs dans la Sierra (Garcia-Martinez, 1987 : 210-224, 377-380) et, semble-t-il, dans les autres régions indiennes (Dehouve, 1990 : 142-150). Le modèle est partout similaire : des villages dépendants (sujetos) construisent une église à un saint patron et tentent d'obtenir un curé : ils deviennent alors cabecera de doctrina (chef-lieu de prédication). Ils tentent alors, parfois avec l'aide du curé, de devenir pueblo cabecera (« village-chef-lieu »). C'est ce que Garcia-Martinez a appelé les « villages de saints » (pueblos de los santos) en opposition aux agglomérations précolombiennes (altepeme) devenues après la conquête des pueblos de indios. Quels sont les avantages de la sécession ? Les habitants ne sont plus soumis aux corvées et aux taxes destinées à l'amélioration du chef-lieu antérieur (construction d'église, financement des fêtes, etc.). Vers 1600, Zacapoaxtla, un autre « village de saints », se sépare de Tlatlauquitepec et devient chef-lieu indépendant (Garcia-Martinez, 1987 : 217-218) ; un demi-siècle plus tard, Quezalan/Cuetzalan se sépare à son tour de Zacapoaxtla, après avoir suivi le même processus (voir carte 2).
Carte 2. La fragmentation des communautés de la Sierra
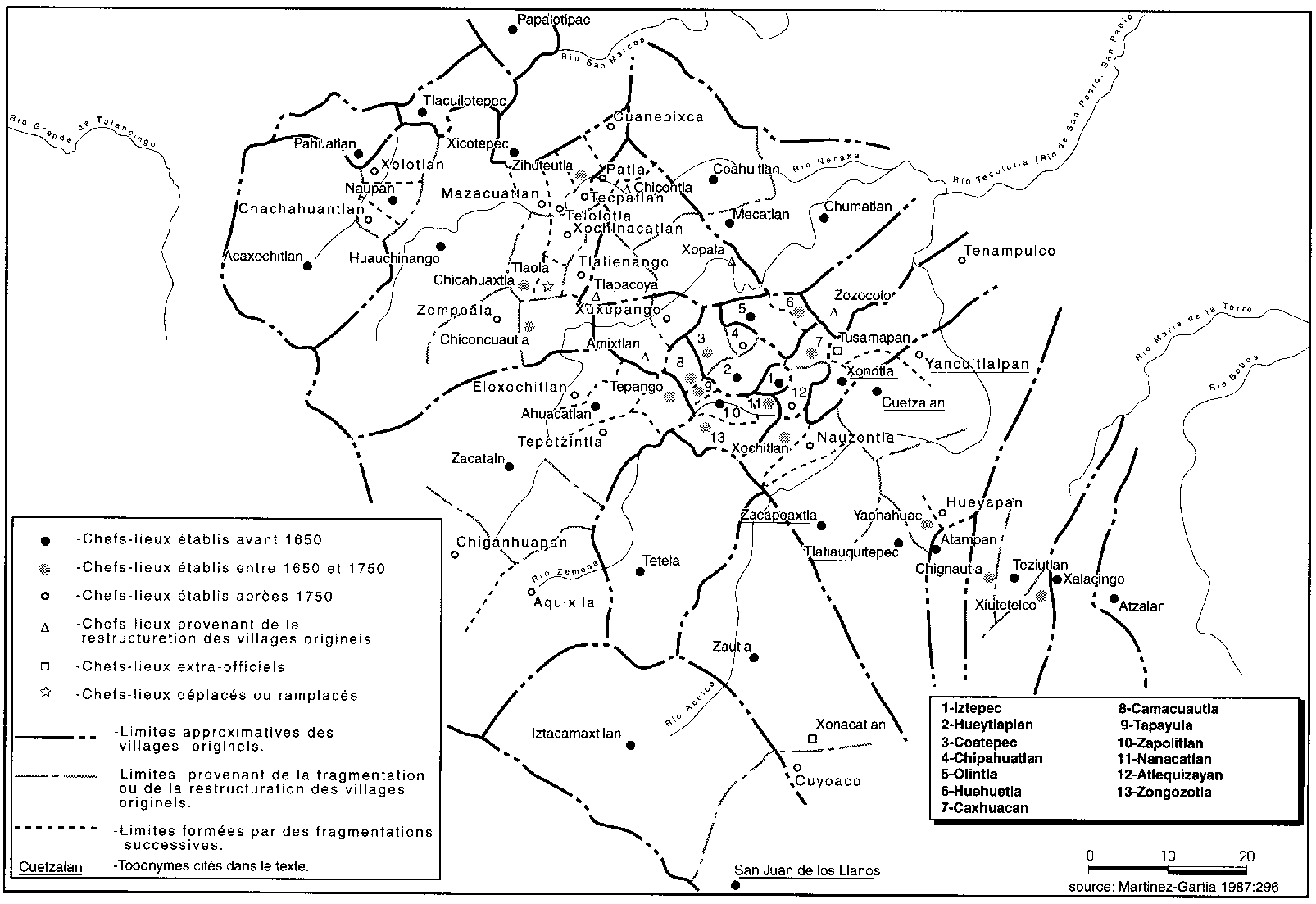
En 1720, lorsque Cuetzalan apparaît dans les archives du chef-lieu de San Juan de los Llanos, c'est donc en qualité de república de indios, c'est-à-dire une communauté autonome possédant son propre gobernador. Ce dernier fait partie d'une délégation de gobernadores autochtones de la Sierra méridionale qui se rendent au chef-lieu régional de San Juan de los Llanos pour protester contre l'imposition d'une corvée de réfection des routes qu'on veut leur imposer à Xalapa, soit à plus de vingt lieues de chez eux (75km). Le Marquis de Balero, vice-roi, leur donne raison malgré les pressions des autorités civiles de Xalapa (AHML, 30/10/1720). Quand on examine l'argumentation des autochtones, on est frappé par leur connaissance des lois en vigueur, voire leur utilisation habile de la méconnaissance du terrain qu'a le vice-roi.
Cinq ans plus tard, la population de San Francisco Quesala se soulève contre le lieutenant et le curé mais aussi contre Juan Antonio « Indien marguillier du village » (Yndio fiscal de este pueblo). Le motif de l'émeute : les vexations et amendes exorbitantes que le premier prélève lors de ses trop fréquentes visites, les prestations en argent et en travail que le second exige constamment et enfin, les « excès » du troisième. Après enquête, ils obtiendront, semble-t-il, gain de cause, bien que les Indiens emprisonnés à la suite de l'émeute seront battus de verges pour s'être soulevés contre l'autorité ! Le document nous apprend que déjà au début du XVIIIe siècle, il y avait au moins un non-indien résident (le curé) et qu'en plus de s'adonner à la culture du maïs, il faisait celle de la canne, le tout grâce à la main-d'oeuvre gratuite des Indiens (AGN Indios, 50 : ff344-347).
Les liens administratifs entre les communautés indiennes et l'administration centrale s'intensifièrent dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, avec les réformes modernisantes de la dynastie des Bourbons : contrôle bureaucratique accru et, peut-être bien, un plus lourd fardeau fiscal. Une série ¾ incomplète ¾ d'états de comptes de communautés indiennes, entre 1779 et 1810, permet de définir approximativement ces prestations. Du côté de l'Église, d'abord. En 1779, Antonio Francisco, Gobernador de Naturales de Quezalan déclare, comme revenu :
90 pesos d'aumônes qu'ont donné les « fils » [hijos, c'est-à-dire les paroissiens] pour les fonctions de l'église, car ils n'ont pas de biens de communauté et ils ne peuvent pas semer, car les terres sont abruptes. (AHML, 1779, s.n.f 1r)
Ses dépenses, quant à elles, s'élèvent à 108 pesos : 72 au curé pour la célébration des messes dominicales et des fêtes, et 36 pour les cierges (ibid.). Le gobernador termine donc l'année avec un déficit de 18 pesos. Il reconnaît cette dette à la fin du document, affirmant qu'elle « est [aussi celle] de ses conseillers municipaux (regidores) et administrateurs subalternes (alcaldes) ». (ibid., f 1v)
Nous n'avons pas les états de comptes au civil pour la même année, mais le successeur d'Antonio Francisco en 1787, Juan Garcia, déclare avoir recueilli 138 pesos et un réal d'impôt pour environ 740 tributaires « à raison d'un réal et demi par tributaire ». Les uniques dépenses admissibles étaient les 72 pesos de salaire versés à l'instituteur que les villages devaient désormais embaucher, une contribution spéciale de 2 % et 4 réaux de frais, le reste étant versé à la « caisse de la communauté » conservée au chef-lieu de district (AHML, 26/3/1788).
Que nous révèlent des documents de ce genre ? En premier lieu, que l'économie de la communauté n'en était plus une de simple subsistance, puisqu'elle pouvait dégager annuellement 228 pesos de redevances, ecclésiastiques et civiles. Pour se faire une idée du pouvoir d'achat d'une telle somme, mentionnons qu'à cette époque un journalier gagnait dans la région deux réaux par jour (AHMC, 1823/8/10, #1), ce qui donne un impôt total, en espèces, équivalant à 912 jours de travail, soit 1,2 jour par chef de famille. Pour ces années, nous n'avons pas trouvé de données précises concernant les corvées, civiles et ecclésiastiques, dont l'existence est cependant attestée par d'autres documents (AHML, 30/10/1720). On voit également que si la croissance démographique permettait à une communauté d'accéder à un statut d'autonomie relative, ce dernier s'accompagnait d'une intégration plus poussée à l'appareil d'État, intégration médiatisée par les responsables élus. Ces derniers devaient être recrutés parmi la couche la plus aisée des paysans, puisqu'ils étaient responsables, en leurs biens propres, du paiement des redevances ecclésiastiques et des impôts civils. Par ailleurs, leur activité était étroitement surveillée ; par le curé et les représentants de l'alcalde mayor, d'une part, par la communauté elle-même, qui se soulevait parfois devant les abus les plus manifestes (ainsi, l'« émeute » de 1725).
Malgré la concision de ce genre de document, un élément permet toutefois de deviner une certaine marge de manoeuvre des Amérindiens. Antonio Francisco affirme qu'ils paient en argent (« aumônes ») « parce qu'ils n'ont pas de biens communautaires et qu'ils ne peuvent semer, car les terres sont abruptes » (AHML, 26/3/1788). Or, nous savons qu'ils avaient obtenu un titre foncier dès le XVIe siècle, que la terre, bien qu'accidentée, est très fertile, ce que confirme un autre document de la même époque (AHML, 1787/6/18, f 5v). En fait, l'abondance des terres communales permit, et ce jusqu'en 1870, la pratique de l'écobuage, ou agriculture itinérante (AHMC, 1877/09/12, cité par Ramirez et al., 1993 : 16). On sait que cette dernière est beaucoup plus productive que la culture permanente, tant que la densité démographique reste faible. Visiblement, les autochtones préféraient payer un impôt fixe en argent, plutôt que de verser intégralement à l'Église le produit d'un champ communautaire, comme cela se pratiquait dans les villages indiens des hauts plateaux. La vente de divers produits agricoles et de volailles dans les marchés régionaux leur procurait plus aisément le numéraire requis.
C'est au tout début du XIXe siècle qu'on peut apprécier la stratégie des autochtones, qui consiste à utiliser toutes les ressources du système colonial pour défendre les droits que ce même système leur reconnaissait. En 1808, s'ouvre le dossier d'un long procès opposant les Naturales de la República de Yndios de San Francisco Quesala à Don Alonso Garcia Luque, notable de San Juan de los Llanos, concernant les terres de Xocoyolotepec (AGN Tierras, 1808). D'après les documents, on peut voir que ce secteur, situé sur les hauteurs au sud de la communauté, et qui n'était pas alors habité ni cultivé par les autochtones, fut d'abord exploré et « évalué », conformément à la nouvelle politique d'accroissement de la production agricole (AHML, 1791/11/25). Puis, selon la plaidoirie de l'avocat des Indiens, des colons métis (de razón) y établirent « un hameau d'importance » (cuantiosa rancheria). Au même moment, les Indiens de Cuetzalan
se voyant dans la nécessité de [...] réparer l'église paroissiale [que] la voracité des flammes avait consumée peu de temps auparavant, pensèrent faire en ces dits monts un défrichement où ils pourraient semer quatre fanèques [environ 24 hectares] de maïs dont le produit leur permettrait de contribuer à des fins si pieuses et si saintes sans sacrifice majeur des habitants, ni de leurs rares biens, ni de leurs personnes (AGN Tierras, 1808 : 7).
Mais Garcia Luque, armé et avec des hommes de main, s'empara par la force du champ en culture, en chassa les Indiens et y mit le feu. Les dirigeants autochtones maintinrent le calme parmi les « quatre cents Indiens » présents, et adressèrent une réclamation aux autorités régionales de San Juan : en vain, c'est leur gobernador qu'on fit jeter en prison, après l'avoir dépouillé du bâton (vara) symbole de son poste (ibid., 9). Ils dénoncèrent la collusion entre les autorités régionales et l'accusé, et obtinrent que le dossier soit transféré à un juge impartial. Le volumineux dossier se termine sur une décision favorable aux autochtones. Cependant, Xocoyolotepec constitue à ce jour la seule communauté de paysans non indiens du municipe de Cuetzalan...
Plus que le résultat du procès, c'est la stratégie déployée par les cuetzaltecos qui nous intéresse. En premier lieu, ils insistent sur le caractère récent (de pocos dias a la presente) de l'occupation illégale des terres de Xocoyolotepec, qu'ils opposent à « leur possession tranquille pendant un grand nombre d'années » (ibid., 14) : or, les premiers colons métis s'y établissent en 1791, soit 17 ans avant le début du conflit, et font baptiser le premier enfant né sur place à l'église de Cuetzalan en 1792 (APC Libro de bautizos, 1792). Un agriculteur de l'endroit affirmera même qu'il a toujours vécu en bons termes avec les Indiens, leur vendant du maïs « car ils préfèrent vendre divers fruits de la terre (grangerias) et acheter le grain qui leur manque » (AHMC c., 1870). La réduction consciente de la durée de l'occupation des terres par les non-Indiens vise à leur enlever toute légitimité, tandis que leur propre légitimité devient double : à l'occupation ancienne vient s'ajouter la sainteté de leur geste, quand ils décident de semer un grand champ de maïs pour avoir de quoi reconstruire l'église incendiée. Compte tenu de la préférence exprimée vingt ans plus tôt pour le travail agricole individuel et l'impôt en argent, il semble raisonnable de croire qu'en semant une grande milpa pour l'église à cet endroit les dirigeants voulaient faire d'une pierre deux coups : recueillir des fonds pour le culte, certes, mais aussi affirmer leur droit collectif sur les terres, ce que les défrichements dispersés ne sauraient faire. Et c'est bien ce qu'a compris Garcia Luque : il a détruit le champ, plutôt que de tenter de s'approprier la récolte. Il resterait à expliquer pourquoi les autochtones ont choisi d'agir à ce moment. Outre des facteurs de leadership impossibles à vérifier, l'incertitude de la conjoncture politique à la veille de la guerre d'indépendance, les migrations internes des hauts plateaux vers la périphérie et les multiples pressions pour l'appropriation privée, par des non-Indiens, des terres « excédentaires » des communautés (AHML, 1787/06/20) ont pu jouer.
Les documents d'archives coloniales nous révèlent donc une communauté qui commence à s'affirmer et à croître dans le cadre colonial, sur la base d'une congregación mise en place au milieu du XVIe siècle. Elle utilise les espaces offerts par ce cadre juridique et politique pour se soustraire à la tutelle des grands chefs-lieux indigènes de Tlatlauquitepec d'abord, de Zacapoaxtla ensuite, et devenir une república de indios, au même titre que ces dernières. Face à la main mise ecclésiastique et civile, elle optera, selon les circonstances, pour l'acceptation (impôts et dîmes), pour la rébellion ouverte (l'émeute de 1725) ou pour une combinaison d'action directe et de poursuites judiciaires (conflit foncier de Xocoyolopepec, à la fin du XVIIIe siècle). Contrairement à l'image d'isolement et d'immobilisme que reproduisent les travaux ethnologiques (voir Beaucage, 1993b), la communauté apparaît à la fois très intégrée administrativement aux structures coloniales, et capable d'actions de protestation qui témoignent d'une conscience des possibilités et limites du système.
Par rapport à la période coloniale, la période républicaine se caractérise par des ruptures profondes, mais aussi par des continuités. Dans les communautés autochtones, la poussée démographique se poursuit, malgré les épidémies qui feront des ravages jusqu'en plein XXe siècle. La croissance est particulièrement sensible dans les zones comme celles de Zacapoaxtla-Cuetzalan, qui étaient faiblement peuplées à l'époque précolombienne. Le document fiscal de 1784, mentionné plus haut, faisait état de 740 tributaires pour Cuetzalan, ce qui nous donne une estimation d'environ trois mille personnes. En 1871, soit moins d'un siècle plus tard, cette population avait plus que doublé, s'établissant à 7799 (Thomson, 1991 : 218). Sur le plan politique, le processus de segmentation qui avait abouti à la création de la República de indios de Cuetzalan avait laissé des séquelles, sous forme de conflits non réglés. Ainsi, les plus anciens documents conservés à Cuetzalan concernent une demande de remboursement de contributions imposées par Zacapoaxtla « quand ces villages étaient soumis à ce chef-lieu, pour reconstruire les édifices municipaux » (AHMC, 1822 s.d.). Le problème des limites municipales se posera tout au long du XIXe siècle. Se développant entre deux chefs-lieux d'origine précolombienne, Tlatlauquitepec et Xonotla, l'ancien « village des saints », Cuetzalan, devra sans cesse défendre ses frontières contre ces deux voisins, qui revendiquent des « droits reconnus depuis des temps immémoriaux » (AHMC, 1861/07/01). Les parties auront recours à la menace et à l'intimidation (AMAT, 1861/02/26), aux versements de compensations (avec Xonotla) et même à l'envoi d'une commission d'arbitrage par les cimes et les ravins (Tlatlauquitepec) pour en arriver à des limites reconnues par tous.
En même temps qu'il luttait pour mener à terme le processus de scission avec ses anciens chefs-lieux, le municipe de Cuetzalan connaissait sur le plan interne, un processus de segmentation, au fur et à mesure de l'expansion de sa population. Là encore, l'identité locale s'affirme d'abord sur le plan religieux, puisque trois communautés rapprochées possèdent chacune son église dès 1725 (AGN Indios, 50 : f344). En 1791, Yancuictlalpan obtenait d'être reconnu comme communauté subordonnée distincte (Garcia-Martinez, 1987 : 378) et en 1822, dans le document cité plus haut, les villages qui forment Cuetzalan exigent d'être remboursés séparément pour les contributions payées à Zacapoaxtla. La segmentation pose sur le plan interne un problème de délimitation et des tensions de même ordre que celles qu'on observait entre les anciennes « républiques » : ainsi Tzinacapan proteste lorsque des gens du chef-lieu « viennent cultiver nos terres » (AMAT, 1862/07/13), Tzicuilan en arrive à une entente sur le tracé de sa frontière avec le chef-lieu (AHMC, 1869/04/22), tandis que Xocoyolo réclame une portion de son territoire qu'elle avait « prêtée » au chef-lieu 56 ans auparavant ! (AHMC, 1873/01/20). Les données d'archives font ainsi réapparaître une dimension séculaire de l'opposition entre les villages et le chef-lieu, opposition bien antérieure aux conflits interethniques, contrairement à ce qu'affirme la tradition orale. Le développement de ces identités villageoises n'aboutira jamais cependant à la scission complète, avec création de nouvelles municipalités.
Si on est frappé par les continuités démographiques et sociales entre la colonie et la république, les niveaux de ruptures sont également évidents. L'ordre républicain tient à se démarquer au maximum de l'ordre antérieur, surtout après la victoire libérale de 1856. Ainsi, la séparation de l'Église et de l'État exige la suppression des noms de saints que les colonisateurs accolaient aux toponymes indiens : San Miguel devient Tzinacapan. En outre, les dîmes et autres redevances ecclésiastiques sont supprimées, et les responsables des confréries (mayordomos de cofradias) doivent remettre à l'État les « capitaux » dont ils disposent (AMAT, 1861/03/09). Les rapports entre les curés et les autorités municipales connaîtront par la suite des périodes d'accalmie et de tensions, ces dernières étant souvent provoquées par des disputes concernant la propriété de terrains ou d'édifices (AHMC, 1873/06/16).
Au lieu du catholicisme, particulièrement détesté par les libéraux puisqu'il s'était étroitement associé au règne conservateur, on met de l'avant de nouveaux rituels et symboles. Suivant le modèle jacobin, ils gravitent autour de la patrie, du progrès et de l'école. Les fêtes patriotiques et civiques sont brillantes et coûteuses, et si les résidents du chef-lieu doivent se cotiser, ceux des villages doivent contribuer pour le travail et les matériaux :
Pour ce qui est de Tzinacapan, quarante hommes, et on les avertit qu'ils doivent se présenter avec le bois et les lianes, Yancuictlalpan, trente [...] demain, sans faute. (AMAT, 1873/10/01).
L'ordre républicain qui pénètre les villages n'agit pas que sur le plan symbolique. Il s'agit d'abord de restaurer l'ordre social. Le demi-siècle qui a suivi l'indépendance a été particulièrement instable au Mexique : des documents épars font état de troupes « insurgées » ou « rebelles » dont la présence est un poids et une menace pour les communautés (AHMC, 1872/11/07). De telles références disparaîtront progressivement des registres entre 1875 et la Révolution (1910). L'État central entreprend d'homogénéiser les structures administratives diverses héritées de la colonie : les restes des villas de espanoles, repúblicas de indios, paroisses, etc. Dans les collectivités indiennes, le maire (alcalde), ses conseillers (regidores), le juge de paix (juez) (personnages dont les titres semblent au siècle dernier plus différenciés que leurs fonctions réelles) déplacent progressivement les instances informelles comme les conseils d'anciens, bien qu'il semble y avoir eu dans ce processus davantage de continuité que de rupture.
Cuetzalan et Tzinacapan, comme d'innombrables communautés métisses et indiennes, sont enjointes d'organiser toute l'activité collective selon ce modèle unique, précisé dans ses moindres détails. Le tout est vérifié par des rapports mensuels qu'exigent les autorités du district. Ces dernières sanctionnaient immédiatement tout écart par rapport à la norme : qu'il s'agisse de la définition des responsabilités respectives des élus locaux (AHMC, 1872/10/6), du nombre d'écoliers inscrits, des présences quotidiennes et des notes obtenues par chacun (AMAT, 1873/06/23). Un tel échange de correspondance suppose la présence dans les villages d'au moins une personne alphabétisée. Plus que le maire (alcalde) et ses conseillers (qui sont encore souvent illettrés) ce sera le secrétaire qui introduira la culture de l'écrit, des documents officiels (actas), à tous les niveaux de la vie municipale. Comme peu d'Indiens (s'il en est) savent lire et écrire, c'est généralement un Métis qui viendra occuper ce poste charnière entre le pouvoir central et les communautés, conférant ainsi à son détenteur un pouvoir interne considérable. L'offensive contre la civilisation de l'oral est renforcée par le rôle nouveau de l'école. Imposée par les Bourbons (avec peu de résultats, semble-t-il) elle fait désormais l'objet d'une attention constante. L'instituteur (dont le salaire constitue souvent le poste de dépense le plus élevé des maigres budgets municipaux) occupe fréquemment le poste de secrétaire.
Sur le plan local, ordonner veut dire d'abord connaître, d'où l'importance du « dénombrement » (padrón). Le plus ancien que nous ayons trouvé (AMAT, 1854 s.d.) provient du village autochtone de Tzinacapan et ne concerne que les hommes. Il semble avoir été effectué à des fins militaires si on en juge par les informations demandées : « âge », « patrie », « état civil ». Particulièrement significative est la rubrique « exceptions » : la seule mention qu'on y trouve, invariablement accolée aux noms d'hommes âgés de 18 à 40 ans est indio puro. À défaut d'autres renseignements, on peut formuler l'hypothèse qu'on avait reçu l'ordre d'inscrire tous les hommes valides, en vue du recrutement. La mention indio puro serait une stratégie de défense : profitant de la clause d'exception applicable aux « indiens purs » (jugés culturellement inaptes au service militaire) on l'aurait attribuée aux plus susceptibles d'être recrutés.
À partir de 1860, il y aura levée annuelle d'un padrón de vecinos (dénombrement de tous les habitants), puis de listes des producteurs de canne à sucre, de ceux qui vendent de la viande au marché, etc. Désormais, c'est le contrôle fiscal qui est prioritaire, et la liste des contributions à payer s'allonge sans cesse : « personnelle », « pour l'école », « de Chicontepec ». L'État considère que la campagne doit supporter le coût de la modernisation et s'ingénie à élargir l'assiette fiscale. Voyant que les Indiens résistent à envoyer leur fils au service militaire, on crée un impôt nouveau, dit de rebajados (des exemptés) (AHMC, 1872/11/29). Avec la suppression des terres communales, appliquée après 1870, les paysans doivent faire enregistrer individuellement leurs lopins... et payer annuellement par la suite 6 % de la valeur estimée de la parcelle à titre d'adjudicacion (AHMC, 1877/03/16). Pour toutes ces contributions on nomme des percepteurs, qui ne peuvent refuser ni démissionner et qui sont responsables de l'intégralité des sommes dues, sous peine de confiscation de leurs biens.
Jusqu'à la deuxième moitié du XVIIIe siècle, le système colonial espagnol reposait, en principe, sur une ségrégation spatiale complète des « Indiens » et des « Espagnols » ; les contacts entre les deux groupes étant réduits à ce qu'exigeait la religion, l'administration et les transactions économiques. Aucun effort systématique n'était donc fait pour l'amélioration des communications avec les communautés de montagne comme Cuetzalan. Dans ces dernières, seule la présence massive de l'église témoignait des congregaciones effectuées au cours du siècle qui suivit la conquête. La république libérale visait au contraire à intégrer les différentes parties du pays et à réorganiser la structure spatiale des communautés selon un modèle unique. On entreprit donc un vaste programme de travaux publics, dans le double but d'améliorer le réseau routier et de doter les villages de casas consistoriales (mairies). Le moyen : la réactivation des corvées, car l'établissement d'une fiscalité moderne n'abolissait pas les prestations anciennes, sauf celles destinées à l'Église, qui devenaient volontaires. La mise à jour annuelle des recensements villageois permettait aux autorités d'avoir une idée précise de la force de travail disponible et de dépister rapidement les réfractaires, passibles de lourdes amendes (AMAT, 1873/ 09/06).
La physionomie des villages en sera changée : au tournant du siècle, les édifices municipaux (l'hôtel de ville, l'école et la prison) viendront former, avec les églises déjà centenaires, un centro dans les communautés indiennes de la Sierra, qu'on presse à l'urbanisation : « place civique » où célébrer les fêtes patriotiques et scolaires et autour de laquelle on trace les premières rues, qui remplacent les étroits sentiers entre les maisons.
Comment les autochtones ont-ils réagi à ces changements ? Leurs réactions sont trop complexes et multiformes pour pouvoir être définies comme une simple « résistance ». Et c'est ici que la figure du leader autochtone Francisco Agustin Dieguillo, ou Palagosti, prend une tout autre dimension. D'un côté, lors de l'intervention franco-autrichienne, il dirige la lutte armée (dès 1862) aux côtés des libéraux insurgés. Après la fin des hostilités, Palagosti refusera toujours de rendre les armes et, en janvier 1868, avec l'appui des anciens, il rassemblera ses miliciens pour détruire des clôtures et des plantations établies par des non-indiens sur des terres de la commune (Thomson, 1991 : 221-222). Son mouvement armé entraînera une panique dans l'élite métisse du bourg de Cuetzalan : curé et secrétaire municipal en tête, ils se replieront sur Zacapoaxtla (id., 224) (c'est à ce moment, semble-t-il, que les archives municipales de Cuetzalan seront détruites). En février 1868, une commission de conciliation, présidée par le général Juan Francisco Lucas, incorpora plusieurs des revendications des autochtones, mais maintint l'application de la Loi Lerdo concernant la privatisation des terres (id., 225). Celle-ci suivra son cours malgré les divers soulèvements armés qui marqueront les années suivantes (id., 239 suiv.).
À ne considérer que ces éléments, on a l'impression qu'il s'agit d'un leader indigène (comme il y en eut tant à l'époque) menant un combat perdu d'avance contre le cours inexorable de l'histoire. C'est l'image qui se dégage de l'analyse de Thomson (1991), laquelle fut élaborée, faut-il le mentionner, à partir des rapports que ses adversaires politiques, la bourgeoisie métisse de Cuetzalan, faisaient parvenir au chef-lieu du district.
Mais ce ne fut là qu'un aspect de son rôle. En 1862, peu de temps avant le soulèvement, on voit qu'il avait été élu regidor (conseiller municipal) au chef-lieu de Cuetzalan : ce qui implique qu'il possédait bien l'espagnol, d'une part, et jouissait d'une certaine estime sur le plan civil, d'autre part, au moins parmi la population indienne du chef-lieu, encore majoritaire à l'époque. Après le départ des Français, et les soulèvements de 1868-1869, il occupera à nouveau des postes publics, tour à tour conseiller et maire, succédant ainsi à ceux que la tradition établit comme ses successeurs. Si Palagosti-guerrillero est un défenseur des terres communales indiennes qu'une poignée d'entrepreneurs veut s'approprier, Palagosti-maire est un ardent propagateur de l'ordre républicain libéral. Comme syndic, il freine certaines tentatives d'appropriation des terres communales (AHMC, 1873/01/10) et obtient la création d'un ejido (terre communale). En même temps, il relance la construction des édifices publics de Cuetzalan (y compris une prison « pour enfermer les ivrognes » ¾ AHMC, 1873/02/17) et insiste pour que les communautés voisines fassent leur part (AHMC, 1872/10/20) ; il promeut la construction et la réparation des chemins et des ponts (AHMC, 1872/11/06) et fustige ses adjoints des villages qui hésitent à percevoir les impôts et à faire effectuer les impopulaires corvées. Il ne cherche pas à provoquer d'antagonismes avec les Métis, cependant, il encourage leur commerce et leur accordera même des concessions sur les pourtours des terroirs villageois, réservant les terres les plus rapprochées à l'agriculture paysanne. Si ses adversaires, c'est-à-dire l'élite commerçante de Cuetzalan, le représentèrent comme le dirigeant d'une guerre ethnique (image identique à celle de la tradition orale indienne), si Thomson voit plutôt en lui un leader agraire, l'examen des archives locales nous le montre à l'image de ce que fut la réponse indienne au projet libéral dans la Sierra : adhésion à ses objectifs sociaux de base (le nouvel ordre républicain, ses structures et ses symboles), utilisation de tous les moyens que le système mettait à sa disposition (les armes comme le pouvoir politique local) et refus de ce qu'il considérait être des « abus », à savoir la concentration de la propriété foncière et l'expropriation de la paysannerie.
Quelle lumière nouvelle cette confrontation de la tradition orale et des documents d'archives vient-elle jeter sur l'ethnohistoire de la Sierra ? En premier lieu, je crois avoir démontré comment ces deux sources, loin d'être simplement complémentaires (comme le voudrait une méthodologie positiviste), représentent ici deux façons radicalement différentes de codifier le présent et le passé. La première, organise l'ensemble des éléments transmis selon une opposition fondamentale entre Nous et les Étrangers, notre manière d'être, à l'indienne (maseualkopan), et la leur (koyokopan). La société autochtone, possédant sa culture propre, y est définie par rapport à elle-même, son isolement relatif étant interrompu par des interactions brutales avec l'extérieur (conquête espagnole, intervention française, révolution). Ces interactions se terminent (ou se termineront) nécessairement par une victoire indienne.
Les archives, au contraire, nous montrent cette même société intégrée dès le XVIe siècle à la société coloniale puis républicaine, et se développant en relation constante avec elles. Plutôt que la dialectique du Nous et de l'Autre, les documents écrits nous présentent un discours et une pratique autochtones centrés sur l'équilibre social, constamment menacé tant par les abus que par le chaos : troubles politiques, délinquance, catastrophes naturelles. L'établissement d'un ordre politique (sur les personnes, les terres, les échanges) et d'un ordre économique (par le marché) constitue une des lignes de force du corpus. Cela n'exclut pas, bien sûr, les contradictions et les conflits d'intérêt : entre chef-lieu et villages, entre le pouvoir central et les paysans, entre Indiens et Métis. Mais, d'après ce que nous trouvons dans les archives, il n'y a jamais eu deux projets de société, l'un indien-rural et l'autre métis-urbain. Lorsque les autorités métisses et les autorités indiennes (celles de 1886 ou celles de 1986) montrent des divergences, c'est lorsqu'il s'agit de définir les bénéficiaires prioritaires de cet ordre et qui va le contrôler : le chef-lieu, dominé par une élite bureaucratique et commerçante, ou la population majoritaire des villages, sous la direction de ses leaders. Entre ces deux pôles, une dynamique historique complexe s'est établie, sur le plan économique, politique et idéologique : la tradition orale autochtone, loin de refléter mécaniquement cette histoire, tend à la reproduire, c'est-à-dire à l'infléchir dans un sens favorable au groupe majoritaire. Quand se présenteront des circonstances propices, comme ce fut le cas lors de l'invasion française et de la Révolution ainsi qu'au milieu des années 70, cette mémoire indienne se mobilisera, ralliant les villageois autour d'un mouvement contestataire (Beaucage, 1987 : 35-38, 1992b : 81-84).
 1. Les données qui relèvent
de la tradition orale proviennent de la recherche effectuée
par les membres du Taller de Tradición Oral del CEPEC,
de San Miguel Tzinacapan, Municipio de Cuetzalan, Puebla.
Le groupe, composé majoritairement d'Amérindiens nahuas,
se consacre depuis plus de dix ans à la collecte, à
la transcription, à l'analyse et à la diffusion des
traditions de la région. (Taller...,
1994). Depuis 1984, grâce à l'aide financière du
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada,
j'ai collaboré à divers projets avec le Taller. De 1989
à 1991, deux équipes furent constituées pour étudier
les archives conservées à San Miguel Tzinacapan de même
que dans le chef-lieu municipal de Cuetzalan ; la première
fut formée de membres du Taller et de moi-même et la
seconde, de Carolina Ramirez, Pablo Valderrama et Gabriel
Jaimez. (Voir Beaucage, 1993a
; Ramirez, Jaimez et Valderrama, 1992.) Je tiens à remercier ici
pour leur collaboration, Don Agustin Alvarez et Don
Blas Gonzalez, qui furent « maires auxiliaires » de
San Miguel. Je suis aussi très reconnaissant envers
Mlle Ema Flores, responsable des archives municipales
à Cuetzalan, qui nous en a favorisé l'accès, et à Mme
Blanca del Raso, directrice du Département d'histoire
à l'Université de Puebla, qui m'a si aimablement recommandé
aux autorités municipales de Libres, pour que je puisse
y compléter la recherche dans les archives. À San Miguel,
je veux aussi exprimer ma plus profonde gratitude à
l'endroit des membres du groupe PRADE, qui s'y consacrent
depuis plusieurs années au développement communautaire,
et m'ont facilité les contacts et le séjour, ainsi qu'à
la famille de Don Pablo Osorio, dont l'hospitalité et
la cordialité ne se sont jamais démentis au cours des
ans.
1. Les données qui relèvent
de la tradition orale proviennent de la recherche effectuée
par les membres du Taller de Tradición Oral del CEPEC,
de San Miguel Tzinacapan, Municipio de Cuetzalan, Puebla.
Le groupe, composé majoritairement d'Amérindiens nahuas,
se consacre depuis plus de dix ans à la collecte, à
la transcription, à l'analyse et à la diffusion des
traditions de la région. (Taller...,
1994). Depuis 1984, grâce à l'aide financière du
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada,
j'ai collaboré à divers projets avec le Taller. De 1989
à 1991, deux équipes furent constituées pour étudier
les archives conservées à San Miguel Tzinacapan de même
que dans le chef-lieu municipal de Cuetzalan ; la première
fut formée de membres du Taller et de moi-même et la
seconde, de Carolina Ramirez, Pablo Valderrama et Gabriel
Jaimez. (Voir Beaucage, 1993a
; Ramirez, Jaimez et Valderrama, 1992.) Je tiens à remercier ici
pour leur collaboration, Don Agustin Alvarez et Don
Blas Gonzalez, qui furent « maires auxiliaires » de
San Miguel. Je suis aussi très reconnaissant envers
Mlle Ema Flores, responsable des archives municipales
à Cuetzalan, qui nous en a favorisé l'accès, et à Mme
Blanca del Raso, directrice du Département d'histoire
à l'Université de Puebla, qui m'a si aimablement recommandé
aux autorités municipales de Libres, pour que je puisse
y compléter la recherche dans les archives. À San Miguel,
je veux aussi exprimer ma plus profonde gratitude à
l'endroit des membres du groupe PRADE, qui s'y consacrent
depuis plusieurs années au développement communautaire,
et m'ont facilité les contacts et le séjour, ainsi qu'à
la famille de Don Pablo Osorio, dont l'hospitalité et
la cordialité ne se sont jamais démentis au cours des
ans.
 2. Au Mexique comme
ailleurs en Mésoamérique ou dans les Andes, les différences
entre autochtones et non-autochtones ne sont pas définies
par des lois (comme au Canada ou aux États-Unis) ni
exprimées d'abord en termes raciaux (vu le métissage
important de la population non amérindienne). C'est
au niveau socioculturel que s'exprime d'abord la différence.
En basse montagne, les Nahuas se désignent eux-mêmes,
ainsi que tous les autres Amérindiens, comme maseualmej
(sing. maseual) par opposition aux « étrangers
» (koyomej, sing. koyot), terme qui inclut
aussi bien les Métis hispanophones du bourg voisin qu'un
ethnologue québécois ! Maseual dérive de maseua
(« métier », sous-entendu « des dieux ») et désignait
les paysans, à l'époque des Aztèques (Siméon, 1885/1965 : 216). Quant
à koyot (« coyote », Canis latrans), l'origine
précise de son sens actuel en nahuat n'est pas tout
à fait claire. À l'époque coloniale, le mot coyote
désignait la personne issue de l'union d'un mestizo
et d'une Amérindienne (Santamaria,
1959 : 225). Après l'Indépendance (1821) le sens
du mot changea radicalement : « Vers 1828, quand la
haine anti-espagnole atteignit son sommet, on leur donna
le surnom injurieux de coyotes » (id.,
308). Les paysans mexicains appellent aujourd'hui coyotes
les intermédiaires qui achètent leurs récoltes. Mentionnons
enfin que dans le folklore amérindien, le lièvre et
le coyote (parfois remplacés par l'opossum et le jaguar)
forment une paire, respectivement, le trickster et son
dupe (Laughlin, 1977
: 67, 367-370 ; Lopez-Austin, 1990).
2. Au Mexique comme
ailleurs en Mésoamérique ou dans les Andes, les différences
entre autochtones et non-autochtones ne sont pas définies
par des lois (comme au Canada ou aux États-Unis) ni
exprimées d'abord en termes raciaux (vu le métissage
important de la population non amérindienne). C'est
au niveau socioculturel que s'exprime d'abord la différence.
En basse montagne, les Nahuas se désignent eux-mêmes,
ainsi que tous les autres Amérindiens, comme maseualmej
(sing. maseual) par opposition aux « étrangers
» (koyomej, sing. koyot), terme qui inclut
aussi bien les Métis hispanophones du bourg voisin qu'un
ethnologue québécois ! Maseual dérive de maseua
(« métier », sous-entendu « des dieux ») et désignait
les paysans, à l'époque des Aztèques (Siméon, 1885/1965 : 216). Quant
à koyot (« coyote », Canis latrans), l'origine
précise de son sens actuel en nahuat n'est pas tout
à fait claire. À l'époque coloniale, le mot coyote
désignait la personne issue de l'union d'un mestizo
et d'une Amérindienne (Santamaria,
1959 : 225). Après l'Indépendance (1821) le sens
du mot changea radicalement : « Vers 1828, quand la
haine anti-espagnole atteignit son sommet, on leur donna
le surnom injurieux de coyotes » (id.,
308). Les paysans mexicains appellent aujourd'hui coyotes
les intermédiaires qui achètent leurs récoltes. Mentionnons
enfin que dans le folklore amérindien, le lièvre et
le coyote (parfois remplacés par l'opossum et le jaguar)
forment une paire, respectivement, le trickster et son
dupe (Laughlin, 1977
: 67, 367-370 ; Lopez-Austin, 1990).
 3. En ce qui concerne
la Mésoamérique, il faut souligner les travaux de Wasserstrom
(1983) et de
Dehouve (1990),
qui ont repris et approfondi, pour deux régions autochtones,
le travail de pionnier de Gibson sur la vallée de Mexico
(1964). La
remise en question des postulats a) historiques du
structuro-fonctionnalisme
par des chercheurs marxistes dans les années 60 et 70
a certes contribué à cette (re)découverte de l'histoire
par les ethnologues ; et ce, même si les processus historiques
révélés par l'enquête différaient souvent beaucoup des
« lois » postulées par la théorie marxiste (Beaucage, 1993b).
3. En ce qui concerne
la Mésoamérique, il faut souligner les travaux de Wasserstrom
(1983) et de
Dehouve (1990),
qui ont repris et approfondi, pour deux régions autochtones,
le travail de pionnier de Gibson sur la vallée de Mexico
(1964). La
remise en question des postulats a) historiques du
structuro-fonctionnalisme
par des chercheurs marxistes dans les années 60 et 70
a certes contribué à cette (re)découverte de l'histoire
par les ethnologues ; et ce, même si les processus historiques
révélés par l'enquête différaient souvent beaucoup des
« lois » postulées par la théorie marxiste (Beaucage, 1993b).
 4. La Sierra Norte de
Puebla, avec une altitude qui varie entre 2200 et 500
mètres au-dessus du niveau de la mer, forme la transition
entre les hautes terres sèches du Mexique central et
la plaine tropicale de la côte. Extrêmement accidentée
mais fertile et bien arrosée, la région a constitué
historiquement une zone de refuge pour les Amérindiens
après la conquête espagnole et l'expansion des grands
domaines sur le plateau. On y trouve actuellement deux
principaux groupes autochtones : les Nahuas, dont l'habitat
s'étend du plateau jusqu'à la basse montagne, et les
Totonaques, qui se concentrent dans cette dernière et
dans la plaine adjacente, au Veracruz. D'après le recensement
de 1990, on peut estimer à plus de 320 000 la population
amérindienne de la Sierra, soit environ 210 000 Nahuas,
103 500 Totonaques et 9500 Otomis (XI Censo Nacional
de Población y Vivienda 1990 (INEGI, 1993 : 74,91)).
Les Nahuas de la Sierra parlent deux dialectes : le
nahuatl, au nord (zone de Huauchimango-Xicotepec) et
le nahuat au sud (zone de Zacapoaxtla-Texiutlan-Cuetzalan).
Je désignerai les gens comme « Nahuas » et leur parler
comme « nahuatl » ou « nahuat », respectivement, conformément
au voeu exprimé par le Taller. Les Amérindiens sont
en grande majorité agriculteurs et cultivent le maïs,
les haricots ainsi que des fruits et des légumes pour
leur subsistance. En haute montagne (autour de 2000
mètres d'altitude), ils s'adonnent aussi au petit élevage
(porcs, poules, quelques vaches) et, traditionnellement,
émigraient vers la côte pendant la morte saison. En
basse montagne (entre 500 et 1000 mètres d'altitude),
le café est devenu la principale culture et une majorité
de paysans dépendent de sa vente pour acheter le maïs
et les autres denrées essentielles. Les Métis hispanophones,
minoritaires dans la Sierra, y forment la population
des chefs-lieux municipaux (cabeceras), où les
plus aisés contrôlent le commerce et l'administration.
Plusieurs d'entre eux possèdent des plantations et des
pâturages dans la campagne environnante. Ces propriétés,
moyennes dans le contexte mexicain, contrastent cependant
avec les parcelles des paysans, amérindiens pour la
plupart. Par exemple, à Cuetzalan, en 1970, 45 % des
paysans possédaient moins d'un hectare, et 41 % avaient
à peine plus de deux hectares. Entre 20 et 33 % des
paysans n'avaient pas de terre et travaillaient comme
journaliers et métayers. À l'autre extrême, six propriétaires
se partageaient 1500 hectares (Dirección
General de Estadistica, 1975 : 63, 75).
4. La Sierra Norte de
Puebla, avec une altitude qui varie entre 2200 et 500
mètres au-dessus du niveau de la mer, forme la transition
entre les hautes terres sèches du Mexique central et
la plaine tropicale de la côte. Extrêmement accidentée
mais fertile et bien arrosée, la région a constitué
historiquement une zone de refuge pour les Amérindiens
après la conquête espagnole et l'expansion des grands
domaines sur le plateau. On y trouve actuellement deux
principaux groupes autochtones : les Nahuas, dont l'habitat
s'étend du plateau jusqu'à la basse montagne, et les
Totonaques, qui se concentrent dans cette dernière et
dans la plaine adjacente, au Veracruz. D'après le recensement
de 1990, on peut estimer à plus de 320 000 la population
amérindienne de la Sierra, soit environ 210 000 Nahuas,
103 500 Totonaques et 9500 Otomis (XI Censo Nacional
de Población y Vivienda 1990 (INEGI, 1993 : 74,91)).
Les Nahuas de la Sierra parlent deux dialectes : le
nahuatl, au nord (zone de Huauchimango-Xicotepec) et
le nahuat au sud (zone de Zacapoaxtla-Texiutlan-Cuetzalan).
Je désignerai les gens comme « Nahuas » et leur parler
comme « nahuatl » ou « nahuat », respectivement, conformément
au voeu exprimé par le Taller. Les Amérindiens sont
en grande majorité agriculteurs et cultivent le maïs,
les haricots ainsi que des fruits et des légumes pour
leur subsistance. En haute montagne (autour de 2000
mètres d'altitude), ils s'adonnent aussi au petit élevage
(porcs, poules, quelques vaches) et, traditionnellement,
émigraient vers la côte pendant la morte saison. En
basse montagne (entre 500 et 1000 mètres d'altitude),
le café est devenu la principale culture et une majorité
de paysans dépendent de sa vente pour acheter le maïs
et les autres denrées essentielles. Les Métis hispanophones,
minoritaires dans la Sierra, y forment la population
des chefs-lieux municipaux (cabeceras), où les
plus aisés contrôlent le commerce et l'administration.
Plusieurs d'entre eux possèdent des plantations et des
pâturages dans la campagne environnante. Ces propriétés,
moyennes dans le contexte mexicain, contrastent cependant
avec les parcelles des paysans, amérindiens pour la
plupart. Par exemple, à Cuetzalan, en 1970, 45 % des
paysans possédaient moins d'un hectare, et 41 % avaient
à peine plus de deux hectares. Entre 20 et 33 % des
paysans n'avaient pas de terre et travaillaient comme
journaliers et métayers. À l'autre extrême, six propriétaires
se partageaient 1500 hectares (Dirección
General de Estadistica, 1975 : 63, 75).
 5. Le livre du Taller
de Tradición Oral n'étant pas encore disponible, les
références renvoient au manuscrit : le chiffre romain
correspond au numéro du chapitre, le chiffre arabe à
celui de la page. J'ai moi-même recueilli les données
orales marquées d'un astérisque. Pour ce qui est de
la provenance des documents d'archives, le sigle AMAT
renvoie aux Archives du Municipe Auxiliaire de Tzinacapan
; AHMC à l'Archivo Historico Municipal de Cuetzalan
; APC à l'Archivo Parroquial de Cuetzalan ; AHML, à
l'Archivo Historico Municipal de Libres ; et AGN aux
Archivo Général de la Nación, à Mexico.
5. Le livre du Taller
de Tradición Oral n'étant pas encore disponible, les
références renvoient au manuscrit : le chiffre romain
correspond au numéro du chapitre, le chiffre arabe à
celui de la page. J'ai moi-même recueilli les données
orales marquées d'un astérisque. Pour ce qui est de
la provenance des documents d'archives, le sigle AMAT
renvoie aux Archives du Municipe Auxiliaire de Tzinacapan
; AHMC à l'Archivo Historico Municipal de Cuetzalan
; APC à l'Archivo Parroquial de Cuetzalan ; AHML, à
l'Archivo Historico Municipal de Libres ; et AGN aux
Archivo Général de la Nación, à Mexico.
 6. Tout étonnante qu'elle
puisse nous paraître, cette conception qui assimile
la conquête espagnole à une tentative de domination
n'est pas unique. Dans un village totonaque d'une région
avoisinante du Veracruz, Alvarez-Santiago rapporte cette
question que lui fit le « Prince Cuauhtemoc » auprès
des heures d'une chorégraphie complexe où s'entremêlaient
« Espagnols », « Maures » et « Chichimèques » : ?Es
cierto que ganaron los indios ? (« C'est vrai que ce
sont les Indiens qui ont gagné ? ») (Alvarez-Santiago,
1988 : 9).
6. Tout étonnante qu'elle
puisse nous paraître, cette conception qui assimile
la conquête espagnole à une tentative de domination
n'est pas unique. Dans un village totonaque d'une région
avoisinante du Veracruz, Alvarez-Santiago rapporte cette
question que lui fit le « Prince Cuauhtemoc » auprès
des heures d'une chorégraphie complexe où s'entremêlaient
« Espagnols », « Maures » et « Chichimèques » : ?Es
cierto que ganaron los indios ? (« C'est vrai que ce
sont les Indiens qui ont gagné ? ») (Alvarez-Santiago,
1988 : 9).
 7. Une recherche sur
la toponymie, effectuée en 1988 par le Taller de Tradición
Oral et moi-même révélait un processus identique d'appropriation
symbolique : le terroir villageois de San Miguel Tzinacapan
est littéralement criblé de toponymes autochtones (au
moins trois cents, pour moins de trente kilomètres carrés)
chacun renvoyant à une « nature socialisée ». Par exemple
: « Les anciens ont vu ici bondir (tsikuini)
des chevreuils. C'est pourquoi ils ont appelé ce lieu
Tzicuilan (" là-où-ils-bondissent »). "
7. Une recherche sur
la toponymie, effectuée en 1988 par le Taller de Tradición
Oral et moi-même révélait un processus identique d'appropriation
symbolique : le terroir villageois de San Miguel Tzinacapan
est littéralement criblé de toponymes autochtones (au
moins trois cents, pour moins de trente kilomètres carrés)
chacun renvoyant à une « nature socialisée ». Par exemple
: « Les anciens ont vu ici bondir (tsikuini)
des chevreuils. C'est pourquoi ils ont appelé ce lieu
Tzicuilan (" là-où-ils-bondissent »). "
 8. Après la défaite
de Maximilien, Juan Francisco Lucas demeura un homme
important dans la Sierra, bien que n'ayant aucun poste
officiel. Son pouvoir se consolida sous le long règne
de Porfirio Diaz (1876-1910), son ancien compagnon d'armes,
quand il réussit à faire placer son homme de confiance.
Arriaga, comme jefe politico du district de Zacapoaxtla.
Dans la région, les légendes les plus diverses entourent
son personnage : qu'il s'amusait à mystifier les hauts
fonctionnaires en s'habillant à l'indienne, et même
qu'on lui aurait offert la présidence de la république,
qu'il aurait refusée en disant : « C'est le peuple qui
commande au président. Je ne serai pas l'épouse du peuple
! » (Taller, 1993 : III : 1).
8. Après la défaite
de Maximilien, Juan Francisco Lucas demeura un homme
important dans la Sierra, bien que n'ayant aucun poste
officiel. Son pouvoir se consolida sous le long règne
de Porfirio Diaz (1876-1910), son ancien compagnon d'armes,
quand il réussit à faire placer son homme de confiance.
Arriaga, comme jefe politico du district de Zacapoaxtla.
Dans la région, les légendes les plus diverses entourent
son personnage : qu'il s'amusait à mystifier les hauts
fonctionnaires en s'habillant à l'indienne, et même
qu'on lui aurait offert la présidence de la république,
qu'il aurait refusée en disant : « C'est le peuple qui
commande au président. Je ne serai pas l'épouse du peuple
! » (Taller, 1993 : III : 1).
 9. On trouve dans le
Codex Mendoza la mention d'un Cuepalan,
accompagné d'un glyphe représentant une poignée de plumes
écarlates sur un socle orné d'une double rangée de dents
(Cooper Clark, 1938
: 4). Le nom (« lieu-de-plumes précieuses ») semble
avoir été donné à plusieurs agglomérations car ce Cuepalan
ne fait pas partie des tributaires de Tlatlauquitepec,
le grand centre politique des Nahuas de la Sierra, à
l'époque précolombienne (ibid., 54). Garcia-Martinez
propose plutôt comme origine le village de Quetzalcoatl
(nom du célèbre Serpent-à-plumes de la mythologie),
situé assez près de l'actuel Cuetzalan
(Garcia-Martinez,
1987 : 162-163 ; voir aussi
Garcia-Payón 1965 : 62-63,
41-43). Le village, peu important numériquement,
aurait été déplacé sur un autre site au milieu du XVIe
siècle (Garcia-
Martinez, 1987 : 307-308). Le toponyme religieux
aurait été modifié, comme d'autres dans la région :
Xolotla (« lieu-du-dieu-Xolotl
» ¾ Cooper Clark, 1938 : 54) devint Xonotla («
lieu-de-l'Héliocarpus
») etc. Faut-il y voir une volonté de rendre signifiant
un nom qui ne l'était plus du fait de l'oubli des anciennes
divinités ? Ou est-on en face d'un élément de ce processus
complexe de « colonisation de l'imaginaire » (Gruzinski, 1988) et de résistance
qu'a été l'évangélisation dans l'empire espagnol ?
9. On trouve dans le
Codex Mendoza la mention d'un Cuepalan,
accompagné d'un glyphe représentant une poignée de plumes
écarlates sur un socle orné d'une double rangée de dents
(Cooper Clark, 1938
: 4). Le nom (« lieu-de-plumes précieuses ») semble
avoir été donné à plusieurs agglomérations car ce Cuepalan
ne fait pas partie des tributaires de Tlatlauquitepec,
le grand centre politique des Nahuas de la Sierra, à
l'époque précolombienne (ibid., 54). Garcia-Martinez
propose plutôt comme origine le village de Quetzalcoatl
(nom du célèbre Serpent-à-plumes de la mythologie),
situé assez près de l'actuel Cuetzalan
(Garcia-Martinez,
1987 : 162-163 ; voir aussi
Garcia-Payón 1965 : 62-63,
41-43). Le village, peu important numériquement,
aurait été déplacé sur un autre site au milieu du XVIe
siècle (Garcia-
Martinez, 1987 : 307-308). Le toponyme religieux
aurait été modifié, comme d'autres dans la région :
Xolotla (« lieu-du-dieu-Xolotl
» ¾ Cooper Clark, 1938 : 54) devint Xonotla («
lieu-de-l'Héliocarpus
») etc. Faut-il y voir une volonté de rendre signifiant
un nom qui ne l'était plus du fait de l'oubli des anciennes
divinités ? Ou est-on en face d'un élément de ce processus
complexe de « colonisation de l'imaginaire » (Gruzinski, 1988) et de résistance
qu'a été l'évangélisation dans l'empire espagnol ?
 Beaucage, P., 1973a.
« Anthropologie économique des communautés indigènes
de la Sierra Norte de Puebla. 1. Les villages de basse
montagne ", », Revue canadienne de sociologie et
d'anthropologie. X, 2, p. 114-133.
Beaucage, P., 1973a.
« Anthropologie économique des communautés indigènes
de la Sierra Norte de Puebla. 1. Les villages de basse
montagne ", », Revue canadienne de sociologie et
d'anthropologie. X, 2, p. 114-133.
 Beaucage, P., 1973b.
« Anthropologie économique des communautés indigènes
de la Sierra Norte de Puebla. 2. Les villages de haute
montagne ", », Revue canadienne de sociologie et
d'anthropologie. X, 4, p. 289-307.
Beaucage, P., 1973b.
« Anthropologie économique des communautés indigènes
de la Sierra Norte de Puebla. 2. Les villages de haute
montagne ", », Revue canadienne de sociologie et
d'anthropologie. X, 4, p. 289-307.
 Beaucage, P., 1987.
Les identités indiennes : folklore ou facteur de
transformation. dans B. Dumas et D. Winslow (dir.),
Construction/destruction sociale des idées : alternances,
récurrences, nouveautés. Montréal, Cahiers de l'ACSALF,
p. 23-42.
Beaucage, P., 1987.
Les identités indiennes : folklore ou facteur de
transformation. dans B. Dumas et D. Winslow (dir.),
Construction/destruction sociale des idées : alternances,
récurrences, nouveautés. Montréal, Cahiers de l'ACSALF,
p. 23-42.
 Beaucage, P., 1989.
« L'effort et la vie : ethnosémantique du travail chez
les Garifonas du Honduras et les Maseuals (Nahuats)
du Mexique ", », Travail, capital et société.
XXII, 1, p. 112-137.
Beaucage, P., 1989.
« L'effort et la vie : ethnosémantique du travail chez
les Garifonas du Honduras et les Maseuals (Nahuats)
du Mexique ", », Travail, capital et société.
XXII, 1, p. 112-137.
 Beaucage, P., 1992a.
Héros civilisateur ou oppresseur ridicule : la représentation
de l'étranger dans la littérature orale maseual (nahuat)
du Mexique. dans S. Harel (dir.), L'étranger
dans tous ses états : enjeux culturels et littéraires.
Montréal, XYZ éditeur, p. 81-98.
Beaucage, P., 1992a.
Héros civilisateur ou oppresseur ridicule : la représentation
de l'étranger dans la littérature orale maseual (nahuat)
du Mexique. dans S. Harel (dir.), L'étranger
dans tous ses états : enjeux culturels et littéraires.
Montréal, XYZ éditeur, p. 81-98.
 Beaucage, P., 1992b.
« Crise des subsistances ou crise des modèles explicatifs
? À propos d'un mouvement indigène et de ses interprétations
", », Anthropologies et Sociétés. XVI, 2, p.
67-90.
Beaucage, P., 1992b.
« Crise des subsistances ou crise des modèles explicatifs
? À propos d'un mouvement indigène et de ses interprétations
", », Anthropologies et Sociétés. XVI, 2, p.
67-90.
 Beaucage, P., 1993a.
The Opossum and the Coyote : Identity and Ethnohistory
in the Sierra Norte de Puebla (Mexico). dans A.
Chanady (dir.), The Concept of Latin American Identity.
Minneapolis, University of Minnesota Press (sous presse).
Beaucage, P., 1993a.
The Opossum and the Coyote : Identity and Ethnohistory
in the Sierra Norte de Puebla (Mexico). dans A.
Chanady (dir.), The Concept of Latin American Identity.
Minneapolis, University of Minnesota Press (sous presse).
 Beaucage, P., 1993b.
Los estudios sobre los movimientos sociales en la
Sierra Norte de Puebla (1969-1989) : actores y espacios
sociales ",. dans S. Sarmiento (dir.), Los estudios
antropológicos sobre movimientos sociales. Mexico,
Anales del Instituto Nacional de Antropologia e Historia
(sous presse).
Beaucage, P., 1993b.
Los estudios sobre los movimientos sociales en la
Sierra Norte de Puebla (1969-1989) : actores y espacios
sociales ",. dans S. Sarmiento (dir.), Los estudios
antropológicos sobre movimientos sociales. Mexico,
Anales del Instituto Nacional de Antropologia e Historia
(sous presse).
 Cooper Clark, J. (dir.
et trad.), 1938. The Mexican Manuscript Known as
the Collection of Mendoza and Preserved in the Bodleyan
Library Oxford. Londres, Waterloo & Sons.
Cooper Clark, J. (dir.
et trad.), 1938. The Mexican Manuscript Known as
the Collection of Mendoza and Preserved in the Bodleyan
Library Oxford. Londres, Waterloo & Sons.
 Dehouve, D., 1990.
Quand les banquiers étaient des saints : 450 ans
de l'histoire économique et sociale d'une région indienne
du Mexique. Paris, Éditions du Centre national
de la recherche scientifique.
Dehouve, D., 1990.
Quand les banquiers étaient des saints : 450 ans
de l'histoire économique et sociale d'une région indienne
du Mexique. Paris, Éditions du Centre national
de la recherche scientifique.
 Durand, P., 1975. Nanacatlan
: société paysanne et lutte de classes au Mexique.
Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal.
Durand, P., 1975. Nanacatlan
: société paysanne et lutte de classes au Mexique.
Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal.
 Dirección General de
Estadistica,1975. Censo agr'cola, ganadero y ejidal
1970 : Puebla. Mexico, Secretaria de industria
y Comercio.
Dirección General de
Estadistica,1975. Censo agr'cola, ganadero y ejidal
1970 : Puebla. Mexico, Secretaria de industria
y Comercio.
 Garcia-Martinez, B.,
1987. Los pueblos de la Sierra : el poder y el
espacio entre los indios del norte de Puebla hasta 1700.
Mexico, El Colegio de México.
Garcia-Martinez, B.,
1987. Los pueblos de la Sierra : el poder y el
espacio entre los indios del norte de Puebla hasta 1700.
Mexico, El Colegio de México.
 Garcia-Payón, J. (dir.),
1965. Descripción del Pueblo de Gueytlalpan, por
el alcalde mayor Juan de Carrión (1581). Xalapa,
Universidad Veracruzana (Cuadernos de filosofia no 23).
Garcia-Payón, J. (dir.),
1965. Descripción del Pueblo de Gueytlalpan, por
el alcalde mayor Juan de Carrión (1581). Xalapa,
Universidad Veracruzana (Cuadernos de filosofia no 23).
 Garfias, Luis, 1983.
La intervención francesa en México. Mexico, Panorama.
Garfias, Luis, 1983.
La intervención francesa en México. Mexico, Panorama.
 Gibson, C., 1964. The
Aztecs Under Spanish rule : a History of the Indians
of the Valley of Mexico (1519-1810). Stanford,
Stanford University Press.
Gibson, C., 1964. The
Aztecs Under Spanish rule : a History of the Indians
of the Valley of Mexico (1519-1810). Stanford,
Stanford University Press.
 Gruzinski, S., 1988.
La colonialisation de l'imaginaire. Paris,
Gallimard.
Gruzinski, S., 1988.
La colonialisation de l'imaginaire. Paris,
Gallimard.
 Instituto nacional de
Estadistica, Geografia e Informatica, 1992. XI Censo
General de Población y Vivienda 1990, Resumen general.
Mexico.
Instituto nacional de
Estadistica, Geografia e Informatica, 1992. XI Censo
General de Población y Vivienda 1990, Resumen general.
Mexico.
 Izard, M. et N. Wachtel,
1991. Histoire et anthropologie. 2. L'ethnohistoire.
dans P. Bonte et M. Izard (dir.), Dictionnaire de
l'ethnologie et de l'anthropologie. Paris, Presses
universitaires de France, p. 336-338.
Izard, M. et N. Wachtel,
1991. Histoire et anthropologie. 2. L'ethnohistoire.
dans P. Bonte et M. Izard (dir.), Dictionnaire de
l'ethnologie et de l'anthropologie. Paris, Presses
universitaires de France, p. 336-338.
 Jaimez, G., C. Ramirez
et P. Valderrama, 1992. Tejuan titalnamikij...
Nosotros recordamos el pasado. Puebla, Gobierno
del Estado de Puebla, Secretaria de cultura (Comisión
Puebla V. Centenario).
Jaimez, G., C. Ramirez
et P. Valderrama, 1992. Tejuan titalnamikij...
Nosotros recordamos el pasado. Puebla, Gobierno
del Estado de Puebla, Secretaria de cultura (Comisión
Puebla V. Centenario).
 Labrecque, M. F., 1974.
Des paysans en sursis : les classes sociales dans
une formation sociale paysanne au Mexique : San Juan
Ocelonacaztla ",. Québec, Université Laval. Thèse
de maîtrise en anthropologie.
Labrecque, M. F., 1974.
Des paysans en sursis : les classes sociales dans
une formation sociale paysanne au Mexique : San Juan
Ocelonacaztla ",. Québec, Université Laval. Thèse
de maîtrise en anthropologie.
 Laughlin, R.M., 1977.
Of Cabbages and Kings : Tales from Zinacantan.
Washington, Smithsonian Institution Press.
Laughlin, R.M., 1977.
Of Cabbages and Kings : Tales from Zinacantan.
Washington, Smithsonian Institution Press.
 Lenclud, G., 1991.
Histoire et anthropologie. 1. Le débat théorique
",. dans P. Bonte et M. Izard (dir.), Dictionnaire
de l'ethnologie et de l'anthropologie. Paris, Presses
universitaires de France, p. 334-336.
Lenclud, G., 1991.
Histoire et anthropologie. 1. Le débat théorique
",. dans P. Bonte et M. Izard (dir.), Dictionnaire
de l'ethnologie et de l'anthropologie. Paris, Presses
universitaires de France, p. 334-336.
 Levi-Strauss, C., 1958.
Anthropologie structurale. Paris, Plon.
Levi-Strauss, C., 1958.
Anthropologie structurale. Paris, Plon.
 López-Austin, A., 1990.
Los mitos del tlacuache. Mexico, Alianza Editorial
Mexicana.
López-Austin, A., 1990.
Los mitos del tlacuache. Mexico, Alianza Editorial
Mexicana.
 Molins-Fabrega, A.,
1956. El códice mendocino y la economia de Tenochtitlan.
Mexico, Libro-Mex.
Molins-Fabrega, A.,
1956. El códice mendocino y la economia de Tenochtitlan.
Mexico, Libro-Mex.
 Mota y Escobar, A. de
la, 1940. « Memoriales del Obispo de Tlaxcala, Fray
Alonso de la Mota y Escobar : Visitas 1609-1624 », Anales
del Instituto Nacional de Antropologia e Historia.
I, p. 191-206.
Mota y Escobar, A. de
la, 1940. « Memoriales del Obispo de Tlaxcala, Fray
Alonso de la Mota y Escobar : Visitas 1609-1624 », Anales
del Instituto Nacional de Antropologia e Historia.
I, p. 191-206.
 Palafox y Mendoza, J.,
1643-1646. Relación de las visitas que realizó
el ilustrisimo y excelentisimo obispo de la Puebla de
los Angeles don Joan de Palafox y Mendoza. Juan
Manuel Pérez Zevallos éd.), Madrid, Biblioteca nacional,
manuscrit no 4476.
Palafox y Mendoza, J.,
1643-1646. Relación de las visitas que realizó
el ilustrisimo y excelentisimo obispo de la Puebla de
los Angeles don Joan de Palafox y Mendoza. Juan
Manuel Pérez Zevallos éd.), Madrid, Biblioteca nacional,
manuscrit no 4476.
 Paré, Louise, 1973.
« Caciquisme et structure du pouvoir dans le Mexique
rural », Revue canadienne de sociologie et d'anthropologie.
X, 1, p. 20-43.
Paré, Louise, 1973.
« Caciquisme et structure du pouvoir dans le Mexique
rural », Revue canadienne de sociologie et d'anthropologie.
X, 1, p. 20-43.
 Santamaria, F.J., 1959.
Diccionario de mejicanismos. Mexico, Porrua.
Santamaria, F.J., 1959.
Diccionario de mejicanismos. Mexico, Porrua.
 Simeon, R., 1965. Dictionnaire
de la langue nahuatl ou mexicaine. Graz (Autriche),
Akademische Druck-U. Verlagsanstalt (Fac-similé de l'édition
de 1885).
Simeon, R., 1965. Dictionnaire
de la langue nahuatl ou mexicaine. Graz (Autriche),
Akademische Druck-U. Verlagsanstalt (Fac-similé de l'édition
de 1885).
 Sioui, G.E., 1989.
Pour une autohistoire amérindienne : essai sur les
fondements d'une morale sociale. Québec, Les Presses
de l'Université Laval.
Sioui, G.E., 1989.
Pour une autohistoire amérindienne : essai sur les
fondements d'une morale sociale. Québec, Les Presses
de l'Université Laval.
 Taller de tradición
oral del CEPEC,1994. Nikininkakiltiaya in tatajmej.../
Yo les oia decir a los abuelitos... : Ethnohistoria
nahuat de San Miguel Tzinacapan, Pue. Mexico, Instituto
Nacional de Antropologia e Historia.
Taller de tradición
oral del CEPEC,1994. Nikininkakiltiaya in tatajmej.../
Yo les oia decir a los abuelitos... : Ethnohistoria
nahuat de San Miguel Tzinacapan, Pue. Mexico, Instituto
Nacional de Antropologia e Historia.
 Thomson, G.P.C., 1991.
« Agrarian Conflict in the Municipality of Cuetzalan
(Sierra de Puebla) : the Rise and Fall of " Pala " Agustin
Dieguillo, 1861-1894 », Hispanic American Historical
Review. LXXI, 2, p. 205-258.
Thomson, G.P.C., 1991.
« Agrarian Conflict in the Municipality of Cuetzalan
(Sierra de Puebla) : the Rise and Fall of " Pala " Agustin
Dieguillo, 1861-1894 », Hispanic American Historical
Review. LXXI, 2, p. 205-258.
 Tremblay, M.-A., 1973.
Les sentiments acadiens. dans M.-A. Tremblay
et G. Gold (dir.), Communautés et cultures : éléments
pour une ethnologie du Canada français. Montréal,
HRW, p. 294-318.
Tremblay, M.-A., 1973.
Les sentiments acadiens. dans M.-A. Tremblay
et G. Gold (dir.), Communautés et cultures : éléments
pour une ethnologie du Canada français. Montréal,
HRW, p. 294-318.
 Vansina, J., 1961.
De la tradition orale : essai de méthode historique.
Tervuren, Annales du Musée royal d'Afrique centrale
(Sciences humaines, no 36).
Vansina, J., 1961.
De la tradition orale : essai de méthode historique.
Tervuren, Annales du Musée royal d'Afrique centrale
(Sciences humaines, no 36).
 Vincent, S. (dir.),
1992. Traditions et récits sur l'arrivée des Blancs
en Amérique. Numéro spécial de Recherches amérindiennes
au Québec. XXII, 2-3.
Vincent, S. (dir.),
1992. Traditions et récits sur l'arrivée des Blancs
en Amérique. Numéro spécial de Recherches amérindiennes
au Québec. XXII, 2-3.
 Wasserstrom, R., 1983.
Class and Society in Central Chiapas. Berkeley,
University of California Press.
Wasserstrom, R., 1983.
Class and Society in Central Chiapas. Berkeley,
University of California Press.
 Weymuller, F., 1964.
Histoire du Mexique. Paris, Presses universitaires
de France.
Weymuller, F., 1964.
Histoire du Mexique. Paris, Presses universitaires
de France.
Pour tout commentaire concernant cette édition électronique:
Guy Teasdale (guy.teasdale@bibl.ulaval.ca)